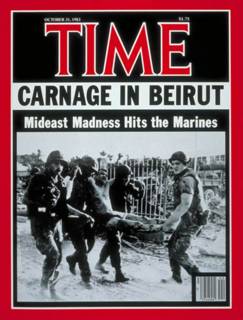http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=132
par Act Up-Paris
Les personnes atteintes par le VIH/sida ont de plus en plus de mal à obtenirl’Allocation Adulte Handicapé ( AAH). Les difficultés qu’elles rencontrent auprès des administrations concernées montrent bien la logique qui préside à l’attribution de ce minimum social : pour les pouvoirs publics, il s’agit d’une aumône qu’il faut mériter, en prouvant constamment qu’on est suffisamment handicapé pour la mériter. Cela est particulièrement vrai pour les séropositifs, que les institutions sociales tiennent pour guéris, donc aptes à l’emploi.
L’Allocation Adulte Handicapé est un revenu qui se mérite. Pour l’obtenir, il faut prouver que1’on est " suffisamment " handicapé pour ne pas travailler, et " suffisamment " pauvre pour percevoir 3 654,50 FF par mois, soit 557,12 euro.
Rendez-vous compte : l’AAH n’est pas soumise à contribution, contrairement, par exemple, à la pension invalidité versée par la Sécurité Sociale. Par ailleurs, l’AAH ne peut être saisie en cas d’impayés et elle n’est pas imposable. Enfin, elle est d’un montant supérieur au RMI. Ce sont autant de " privilèges " qui font que, pour bénéficier d’une telle somme, il vous faut rendre constamment des comptes. De fait, l’obtention de l’AAH relève du parcours du combattant.
C’est particulièrement vrai pour les personnes atteintes de handicaps évolutifs, comme ceux liés à l’infection au VIH/sida. Bien sûr, comme n’importe quel usager d’une institution sociale, une personne séropositive sera confrontée aux problèmes inhérents aux pratiques administratives comme les délais trop longs de traitement des demandes. Mais pour les malades du sida, ces " dysfonctionnements " ont quelque chose d’obscène : Cleews Vellay ancien président d’Act Up, a reçu son AAH quelques semaines après sa mort. Et ce cas n’est pas isolé.
Aujourd1hui, la logique implicite à laquelle tout demandeur d’AAH séropositif doit s’affronter est la suivante : il existe des traitements (trithérapies) qui peuvent contrôler le virus, donc les séropos et les malades du sida vont bien, donc ils peuvent travailler pour gagner leur vie. Depuis l’arrivée des trithérapies, la logique d’un retour forcé au travail s’impose à n’importe quel malade qui prétend à cette allocation - parasite fraudeur en puissance pour les administrations.
Imaginons : vous êtes séropo, vous faites une demande d’Allocation Adulte Handicapé. D’un bout à l’autre du dispositif, tout vous oblige à faire vos preuves, tout est là pour vous rappeler que vous devriez normalement travailler, donc pour décourager à faire valoir vos droits.
1 / Vous devez d’abord faire remplir un certificat médical par votre médecin traitant. Ce certificat doit être le plus détaillé possible, et inclure tous les aspects de la pathologie qui handicapent votre vie quotidienne : ceux liés aux affections opportunistes, aux effets secondaires des traitements, aux répercussions psychologiques et à la fatigue. Mais le formulaire est inadapté à la description de polyhandicaps comme ceux liés au VIH. Par ailleurs, de nombreux médecins traitants ont encore du mal à reconnaître les effets secondaires comme handicaps majeurs à notre vie quotidienne. Résultat : les certificats se contentent trop souvent de signaler des marqueurs biologiques qui ne donnent pas une idée exacte de l’état de santé des personnes atteintes. On peut avoir un bon taux de CD4 et une charge virale indétectable, tout en étant incapable de travailler. À cette étape du parcours, c’est l’ensemble de la relation malade - médecin qui est en cause, et la capacité de nos praticiens à voir en nous autre chose que des données biologiques. Mais il s’agit aussi un problème de fonctionnement administratif. En janvier 1999, Act Up-Paris obtenait la diffusion, dans tout dossier de demande d’AAH, d’une note d’information aux médecins traitants, qui les incitaient à remplir de façon détaillée les certificats médicaux. Cette notice a circulé six mois, puis a disparu, sans que les administrations ne s’en émeuvent.
2 / Votre dossier est maintenant préparé. Vous l’envoyez à la COTOREP (Commission Technique pour l’Orientation et le Reclassement Professionnel).Une équipe technique, composée de médecins, de travailleurs sociaux, de représentants d’usagers et de syndicats, doit vous attribuer un taux de handicap, duquel dépend l’obtention de l’AAH, et éventuellement d’autres prestations. Le taux de handicap est fixé en fonction d’un guide-barème, dont la dernière version date de 1993.
Concernant le VIH, cet outil de référence est caduc, puisqu’il ne prend pas en compte les multithérapies (arrivées en 1996) et leurs effets secondaires. Des circulaires sont venues régulièrement rappeler aux COTOREP la nécessité de tenir compte de ces éléments. Mais ces textes n’ont aucune valeur : les administrations reçoivent des dizaines de circulaires de ce genre par semaine, et n’en tiennent aucunement compte, sauf si des associations font pression. Résultat de ce flou artistique : l’attribution de l’AAH varie d’une COTOREP à l’autre, d’un département à l’autre. C’est l’arbitraire qui domine.
Dans le cas du VIH, cet arbitraire est renforcé par les préjugés des équipes techniques sur cette infection " évolutive ". Les demandes émanant de séropositifs représentent une très faible proportion des demandes générales d’AAH (moins de 0,5 % à Paris). Les médecins des COTOREP sont donc peu familiarisés avec les problèmes spécifiques que posent ce virus et ses traitements. Ils sont ainsi enclins à suivre une logique martelée par les pouvoirs publics, qui n’a rien à voir avec des impératifs de santé publique et de prise en charge sociale : celle des restrictions budgétaires, et du retour forcé au travail. On retrouve par exemple cette logique, dans un rapport écrit par les Inspections Générales des Finances et des Affaires Sociales (IGF et IGAS), rendu public en janvier 1999. On y lit que de nombreux handicaps sont devenus réversibles grâce aux progrès médicaux et techniques. Seuls exemples cités : la surdité et l’infection à VIH. Pour l’IGAS et l’IGF, un sourd avec un appareil est un non-sourd ; un séropositif sous trithérapie est séronégatif, et n’a plus besoin de prestations pour handicapés. Il peut, il doit aller travailler.
Conséquences de cette logique : les premières demandes ou les renouvellements d’AAH sont de plus en plus souvent refusés, ce qui obligent les malades à des recours longs et fastidieux, à des convocations devant les équipes techniques qui tournent très souvent à des séances d’humiliation. Ainsi de ce malade, convoqué par le tribunal du contentieux de la COTOREP de Paris, qui arrive devant ses " juges " avec un énorme dossier médical pour faire valoir ses droits et à qui un médecin-expert affirme : "puisque vous êtes capable de faire des efforts pour rassembler toutes ces pièces et vous battre au contentieux pour obtenir l’AAH, vous devez être capable de tenir un emploi, non ?". Le malade en question était atteint d’un cytomégalovirus (CMV) qui le rend aveugle et prenait à l’époque une trentaine de médicaments par jour.
On pourrait espérer un léger progrès. Le guide-barème a fait l’objet d’une révision, en partenariat avec les associations. La nouvelle version, qui devrait être effective au premier semestre 2002, prendra mieux en compte les effets secondaires des traitements ou encore la fatigue liée à l’infection. Mais si aucune formation particulière n’est faite auprès des équipes techniques pour compenser la logique du retour au travail, ce nouveau guide restera un outil abstrait et théorique.
3/ Il faut bien comprendre les conséquences des refus sur les personnes. Dire à une personne qui s’estime incapable de travailler qu’en fait, elle n’est pas assez malade pour obtenir un minimum social, c’est tout simplement l’inciter à se rendre encore plus malade. Les personnes qui sollicitent Act Up-Paris suite à un refus d’AAH menacent régulièrement d’arrêter leurs traitements dans " l’espoir " d’aggraver leur état de santé et d’obtenir enfin l’allocation. Cette stratégie, qui est rarement consciente, révèle bien l’obscénité d’un système qui entend faire passer un droit fondamental, le droit à un revenu, pour un privilège.
4/ La COTOREP décide enfin que vous avez droit à l’AAH. Votre dossier passe ensuite auprès d’une Caisse d’Allocations Familiales, organisme verseur, qui va calculer le montant auquel vous avez droit, en fonction de vos ressources. De nouveaux problèmes se posent alors. Ce calcul des ressources se fait sur l’année civile antérieure. Entre votre situation financière, et celle qui est prise en compte, plusieurs mois se sont écoulés. Si vous avez eu un emploi, votre salaire sera pris en compte, votre AAH réduite, parfois à zéro, alors même que vous ne disposez plus d’aucun revenu. Commencent alors des comptes d’apothicaires, des démarches sans fin auprès des caisses, qui n’aboutiront en général jamais si vous n’êtes pas assisté par une association.
Autre conséquence : de nombreux séropositifs, qui bénéficient de l’AAH, souhaitent retravailler. Ils trouvent un emploi et sortent du dispositif de l’allocation. Mais après quelques mois, ils s’avèrent incapables de tenir leur emploi. Ils n’ont pas assez cotisé pour bénéficier d’une pension invalidité ou d’un arrêt longue maladie ; ils retournent donc dans le système de l’AAH. La CAF prend alors en compte les revenus procurés par l’emploi, et réduit d’autant, pour une durée d’un an, le montant de l’allocation, ce qui conduit donc à une précarisation des séropositifs.Depuis plusieurs années, les associations, y compris en dehors du milieu sida, demandent le cumul de l’AAH avec un revenu lié à l’emploi - ne serait-ce que pour 12 mois. Elles exigent aussi qu’en cas de retour au système de l’AAH, l’intégralité du montant leur soit immédiatement versée. Ces revendications ne sont évidemment pas entendues : cela signifierait que les pouvoirs publics, et le gouvernement, acceptent l’idée d’un revenu déconnecté du travail, quand bien même il le serait pour une courte période et ne s’adresserait qu’à une population précise, les handicapés.
5/ A-t-on besoin de montrer à quel point il faut être méritant pour bénéficier de l’AAH ? Voici encore deux exemples.Le montant de l’AAH est considérablement réduit quand vous êtes détenu, hospitalisé ou hébergé en centre de moyens séjours. La logique est claire : dans ces institutions, vous êtes nourri, logé et blanchi. Les pouvoirs publics ne vont pas, en plus, vous verser une allocation. Les sans papiers atteints d’une pathologie grave ne sont pas expulsables. Ils bénéficient d’un " sous-titre " de séjour, des autorisations provisoires (APS) d’une durée de trois ou six mois renouvelables. Ce document ne leur permet pas de bénéficier de l’AAH car les CAF refusent de les reconnaître. Les étrangers malades ont donc le droit de rester sur le sol français et de s’y faire soigner. On ne va pas, en plus, leur donner de quoi vivre.
Minimum social destiné à assurer aux personnes handicapés des moyens d’existence, l’AAH est dans les faits une aumône auquel l’Etat ne consent que si on a montré patte blanche, après un long parcours du combattant. Tout est là pour vous rappeler, c’est bien connu, que "le travail, c’est la santé". Surtout quand ce travail vous procure un revenu et économise à l’Etat quelques sous.
La résistance à cette logique passe par une analyse rigoureuse des textes, une information systématique aux demandeurs d’AAH, la recherche du contentieux et de jurisprudence favorables aux malades. Mais elle passe aussi par l’affichage d’un choix de vie, et par le refus de voir nos vies résumées au travail salarié. Ce choix, n’importe qui peut le défendre. Dans le cas des malades du sida, il prend une résonance particulière. E., gravement atteint par le VIH, membre d’Act Up, témoignait récemment : "Bien sûr, j’ai l’air en pleine forme. Je milite, donc je peux travailler, non ?". Il décrivait ensuite l’historique de son infection : séropo en 1989, méningite en 1992, licenciement, surendettement, mycobactéries, épilepsie, dépression nerveuse en 1995, 54 kg pour 1 mètre 76 en 1995, hospitalisations à répétition, douleurs rachidiennes, problèmes oculaires, tumeurs ; puis les traitements, la restauration partielle du système immunitaire, compensée par les effets secondaires. Et pourtant, à cette personne, la COTOREP demande encore des comptes. E. répond : " il n’est absolument pas question de reprendre mon activité qui consistait à rédiger ou faire rédiger des contrats internationaux bourrés de pièges destinés à sauvegarder les intérêts des banques. Mon sida m’a appris à comprendre ce que je ne veux pas contribuer à alourdir le malheur des autres pour que mon employeur se fasse du fric. Alors, oui, je suis retourné au militantisme politique ". Aujourd’hui, E. est en échappement thérapeutique, sa tumeur s’est aggravée. Il devra présenter un nouveau dossier d’AAH en juin 2002.
Act Up-Pariswww.actupp.orgPermanence juridique et gratuite tous les mercredi de 14h à 18h.actdroits@actupp.org
jeudi, octobre 07, 2004
mercredi, octobre 06, 2004

Avi -- Death in a cemetery -- 07.23.04
Death in a cemetery
By: Gidon Levy
How many of us can imagine the night of horror that the Salah family endured? To lie on the floor of the living room for what seemed an eternity, embracing as one being, trembling with fear as the house was blasted with bullets and missiles; to watch the sniper's laser ray doing its dance of death across the apartment, searching out its victims; to see the missiles slamming into the walls of the house, missile after missile, as though an earthquake had struck; to get to their feet in the dark following the order to evacuate the building before it was demolished; to try to open the front door and discover that it had been twisted out of shape by the gunfire and couldn't be opened; to open a window and try to shout to the snipers, in the dark of the night, that the door was jammed; to see the father of the family collapse from a bullet fired into his neck by a sniper; to see the son collapse a few minutes later from a bullet in his cheek fired by a sniper; to watch, helpless, as your son lies on the floor, the life ebbing out of him, next to his dead father, and to cry for help, but to find that the soldiers will not allow anyone to enter; then to undergo an interrogation and humiliation; and to discover that the entire contents of the house had been destroyed.
That was the night of horror of the Salah family: the father, Prof. Khaled Salah, 51 at his death, founder of the Department of Electrical Engineering at An-Najah University in Nablus; his wife, Salam, and their three children, Diana, 23, Mohammed, 16, and Ali, 11, all of whom were at home that night. Fortunately for the firstborn, Amer, he was in Boston, where he is an engineering student. It was a night of horror on which the father, possessor of a Ph.D. from the University of California, Davis, and a member of the Israeli-Palestinian Peace Committee at An-Najah, was killed, along with his son, Mohammed, a boy who loved soccer and dreamed of becoming a pharmacist, who lay dying on the floor for lack of medical treatment, which the soldiers denied him.
Maybe you saw them. Two years ago, during the Mondial (the World Cup of soccer), Channel 2 News correspondent Itai Engel broadcast a report of his impressions from a house in Nablus where he had watched the game between Brazil and Turkey as a guest of the Salah family. Engel was flabbergasted this week when told what had happened to the family that hosted him. The boy too? The boy, too. He said he had been charmed by them, by the father and his son, both of them avid soccer fans. When asked about the possibility of a game between Israel and Palestine, Khaled consulted with Mohammed and then replied, "We're better, but it'll be best if you win, because we'll be in for it if we beat you." They talked about peace and about soccer.
Salam, the widow and bereaved mother, a survivor of that night, found it difficult this week to remember the television piece and her loved ones' remarks about peace. It's important for her that the Israelis know that Khaled was a man of peace. Between fits of crying, still in shock, it's important for her to tell the Israelis in detail what happened in the pre-dawn hours of July 6 in her home on Saka Street, in Nablus.
Salam Salah got home from a wedding in the city a little before midnight. Only she and Diana had attended the family wedding. Mohammed stayed home with his father, watching television and waiting for the candies his mother would bring from the party. Mohammed was very fond of the white and pink wedding sweets stuffed with walnuts. No one could have imagined that those would be the last candies he would ever eat. Diana, who, like her brother Amer, was born in California - both are American citizens - holds a degree in business administration from An-Najah. She, too, was getting ready for her own wedding, a large-scale affair that was set for next month.
They soon went to sleep. Mohammed was an anxiety-ridden boy. Born into the first intifada in the tough city of Nablus, reaching adolescence as the second intifada erupted, he was a habitual nail-biter. He sometimes got nosebleeds, when the tension in Nablus rose. Salam says it might have been because they overprotected the boy.
At a quarter to two they woke up in a fright to the sound of a powerful blast. Salam and Khaled leaped out of bed and looked out the window of their bedroom. They saw nothing. From the window of Diana's room they spotted dark forms of soldiers surrounding the building. It was only from the kitchen window that the full picture became clear. "It's like hell," Khaled whispered to his wife. The whole area was swarming with snipers, tanks, helicopters and other army forces that had come to apprehend or liquidate wanted individuals who were probably hiding in the ground-floor apartment.
Their building is situated high on Saka Street, wedged on the hillside, with Nablus spread out below. The residences in the building are spacious. Two neighbors are physicians, and Sami Aaker, the owner of a sewing factory that produces garments for Israeli fashion houses is another neighbor. Aaker's home now lies in ruins, like that of the Salah family.
Khaled herded the children into the living room and they lay on the floor, folded into one another, five members of a family like one body. From time to time, another missile or shell hit the apartment and exploded, casting a lurid light, like fireworks. Occasionally searchlights or the snipers' red laser rays lit up the darkened living room. The electricity came and went. The door of the refrigerator, damaged along with everything else in the house, opened wide and the yellow light supplied a bit of illumination. Salam and Khaled called everyone they could think of on Mohammed's mobile phone, trying to find out what was happening. The shooting didn't stop for a second, and their home was being gradually destroyed. They called relatives, asking them to do something, fast.
One relative called the U.S. consulate in Jerusalem, but even the long arm of all-powerful America, whose nationals were in the besieged apartment, was of no avail. One missile had already slashed into the bedroom, another into the kitchen. Khaled's mobile phone rang in the bedroom, but no one could get to it. They cried, prayed, shouted, fell silent. And embraced one another. They had a Koran and they read verses from it in loud voices, so people would hear.
"It was a nightmare. I will never recover from it. No horror movie I have seen can compare to it," says Salam, who wears black mourning clothes. Five missiles had already struck the house. Khaled tried to calm them: "It's only property damage, no one has been hurt." Salam says he was strong and knew no fear. They just didn't want him to move and risk being hurt.
They heard the windows shattering, the water streaming from pipes that had burst and the perfumes flowing out of bottles that broke one after the other, their scents wafting through the apartment. From above they heard the sound of a helicopter. The battle for the house was at its height. "We phoned and phoned but everyone was helpless. It was war, and my feeling was that none of us would survive it." It went on that way for an hour and a quarter, until 3 A.M.
When quiet fell, Salam shouted, "Please, please, we are a family of peace. My name is Salam, shalom." The quiet continued for a bit, and then the shooting resumed. Immediately afterward, the Israeli force ordered everyone to leave the building, because it was going to be blown up. The order was given through a loudspeaker, in Arabic. "Anyone who doesn't come out will have the building blown up with him inside," the soldiers threatened.
Khaled got up first. "We're all right, everyone is all right," he whispered. He walked toward the corridor and turned on a light. Salam told the children to wait until he could see what was happening. But the shooting started again and Khaled hurried back to the living room. When the shooting died down he again made his way toward the front door and tried to open it. However, the door had been bent out of shape by the gunfire and the key didn't work.
Unable to open the door, and taking seriously the soldiers' threat to blow up the house with them inside, Khaled went to the bedroom, opened the window, raised his hands and shouted to the soldiers, in English, "Sir, sir, we need help. Please come and open the door. I am a professor, we are people of peace. We have American passports." There was no response. Khaled tried again, this time in Arabic: "Help, help, we need help."
A split second later, Salam heard three shots. Khaled fell silent. She would never hear his voice again. Inside the room, the terrifying red laser ray pranced across the walls.
Salam crawled over to her husband and found him lying on the floor, between the bed and the window. At first she saw no blood, but he was no longer breathing. Then she saw the hole in his neck. "Diana, Diana," she screamed, "they have killed your father."
Then she noticed Mohammed lying on the carpet next to Diana. "What happened, Diana?" she cried. Diana said nothing. Salam quickly moved her son, revealing his mouth. Blood was flowing from his mouth and his cheek was split open. She tried to stanch the blood coming out of his cheek using paper towels. At first, she says, she thought it was a superficial wound. The boy groaned. His eyes were wide open and he emitted strange noises. His eyes pleaded for help, but his mother had only the paper towels. She opened the screen window in the room and shouted hysterically to the soldiers, "You killed my husband and my son." She says she heard a soldier laugh.
"Shut up, woman," the soldier commanded her, in Arabic. And again a red laser beam skitted around the room.
"I will never understand how Mohammed was killed. Maybe one day I will know. Khaled raised his hands, so he was a convenient target for them. Him they killed in cold blood. They let him finish speaking and then they killed him. But how Mohammed was killed I don't understand. I shouted like a madwoman: `Help, my son is alive, we have to save him.' They laughed and told me to shut up. The soldier who was laughing was standing below, on the street. I sat on the floor and kept on shouting like a crazy person. I pounded on the door until my hands were injured. I don't know how those curses came out of me. I called for help, Diana and Ali were crying hysterically, and the soldiers threatened to blow up the building with us inside."
Mohammed was still alive. Diana also shouted to the soldiers that they had two neighbors who are physicians, let them at least send over one of them or let an ambulance get through. Salam says that every time their shouting rose in pitch the soldiers threatened to shoot them unless they shut up. Finally the soldiers said they would send someone. They sent a human shield, using the outlawed "neighbor procedure," in this case the neighbors' 15-year-old son. The lean boy pushed the door from outside, Salam pulled from inside, and at last the door opened.
"We went out in our pajamas with our hands raised," said Salam. "The soldiers spoke to us humiliatingly. I shouted that my son and my husband are killed and they laughed at us, imitating my shouts. They took us to the neighbors' apartment. Diana asked where she should sit and a soldier said, sit on your bottom. When I asked to see the commanding officer, they laughed at me. When I said I wanted to be with Mohammed they imitated me. This is the most criminal and most cruel army in the world. It was murder in the first degree."
At 6:15 A.M., four and a half hours after the attack began, the soldiers allowed a Palestinian ambulance to drive up to the building. The father and the son were dead. Salam was taken for interrogation by "Captain Razel" from the Shin Bet security service, who questioned her about the wanted men who had hidden in the apartment below. She had no idea, she says, what was going on outside.
And that wasn't the end of it. "After all that they went into the house and shot at everything they found. Everything. There isn't a dress, there isn't a towel they didn't shoot at. At the computer, the refrigerator, all our belongings, they destroyed everything. They didn't leave us so much as a pair of socks. They destroyed everything. A home of 20 years, all our memories, all our dreams, our whole history. Imagine to yourself what's in a home of 20 years. They destroyed it all. My husband's books. I don't understand why. They just wanted to show us how strong they are and how cruel."
What do the soldiers who were involved think now? The sniper who shot a father and his son to death, and those who denied the dying boy medical assistance? The army issued a statement the next day: "Dr. Salah and his son Mohammed were apparently killed by IDF gunfire, but there was no intention to do them harm. Because of the shooting of the wanted man from the building, the soldiers were compelled to shoot in different stages at every floor and at the roof of the building, and it's possible that in one of the instances the soldiers didn't identify the sources of fire correctly or were forced to open fire at suspicious movements. Because of the continuation of the event and the lack of information about whether there were additional wanted individuals in the building, it was not possible to send medical teams into the building."
Sirens wail in the main streets of Nablus. Another funeral procession - Yasser Tantawi, 21. His brother, Khaled, 19, was killed two months ago. Both are from the city's Balata refugee camp. A Swedish volunteer, Henryk Larsen, a medical student from Uppsala University, who joined an ambulance of the Medical Relief Organization, was an eyewitness to Yasser's killing last Saturday night.
Youngsters threw stones at Jeeps, the soldiers opened fire, Yasser was wounded in the leg and fell to the ground. The event took place in the camp's cemetery. Larsen tried to treat the wounded man, but came under fire and had to retreat. He saw Yasser's body jolted back and forth as the soldiers kept shooting at him. They shot him, he says, after he had already been wounded in the leg.
Dr. Rasan Hamadan, from the Medical Relief Organization, says that about 10 bullets were found lodged in Yasser's body and that the medical team reported that he was unarmed. Larsen, too, says he saw no weapon.
The response of the IDF Spokesperson's Office: "During operational activity by an IDF force in Balata refugee camp the force came under fire and a number of explosive devices were thrown at it. The soldiers opened fire at a terrorist armed with a Kalashnikov rifle who was advancing toward them, and killed him. In the complex reality in which the IDF operates, maximum efforts are made to avoid injury to the innocent. At the same time, in the case of armed individuals who are endangering IDF soldiers and those around them, it is the soldiers' obligation to prevent them from acting."
Two days later, on Monday of this week, soldiers killed another stone-thrower in the Balata camp cemetery. His name was Husam Abu Zeitouna. He was 14.
Posted by Hello
lundi, octobre 04, 2004
Une lecture de :
Une lecture de La guerre civile aux États-Unis de Marx et Engels
« On peut tromper tout le monde pendant un certain temps et certains pour toujours, mais on ne peut tromper tout le monde éternellement »
Abraham Lincoln[1]
Contrairement à l’image communément véhiculée qui fait de Karl Marx un observateur de situations essentiellement européennes, ce dernier a su être un témoin privilégié de la situation politique précédant la Guerre civile aux États-Unis. En effet, il a pu observer de près le climat de tension, les bases de celui-ci, et le développement d’un climat de guerre civile en terre d’Amérique, qui se développait entre le Nord et le Sud de l’Union. Marx, qui dépouillait aussi les journaux d’outre-Atlantique, qu’ils soient anglais, français voire même russe en profitait même pour écrire certaines chroniques à l’attention de journaux américains tels le New York Daily Tribune. Il se prêtait aussi au jeu pour le compte de journaux allemands comme le Die Presse, en plus d’entretenir une correspondance soutenue avec son collaborateur Friedrich Engels. L’objet du travail consistera en une étude critique de l’ouvrage La guerre civile aux Etats-Unis de Marx et d’Engels. Il est à noter que les écrits militaires rédigés avec l’aide d’Engels n’ont pas été retenus pour les fins de l’étude, qui portera plutôt sur l’évolution des facteurs économiques et politiques dans l’étude qu’en fait Marx. Nous aborderons donc en premier lieu le rapport développé tout au long des textes de Marx entre le colonialisme et puis l’impérialisme. En second lieu, nous traiterons de la question de la propriété, plus particulièrement du rapport entretenu entre la propriété publique et la propriété privée, dans le développement du capitalisme en terre des États-Unis d’Amérique. Enfin, il sera possible de développer sur la distinction entre la ville et la campagne, le tout évidemment dans le cadre d’une analyse centrée sur la rupture entre deux modes de production différents, soit le mode de production agraire, extensif et précapitaliste du Sud et le mode de production industriel, intensif et capitaliste propre au Nord de l’Union américaine.
Rapports entre colonialisme et impérialisme
Colonialisme en Amérique du Nord
En tout premier lieu, les origines coloniales des États-Unis d’Amérique apparaissent comme importantes si l’on veut saisir tous les soubresauts de leur histoire. Ainsi, la colonie américaine sera ouverte sur la côte Est et d’abord développée comme une colonie de peuplement par les Britanniques. Ce mode de développement s’oppose bien entendu à un développement de colonie-comptoir plus propre à l’émergence d’un capitalisme marchand fondé sur l’échange, tels qu’ont pu le pratiquer par exemple les Hollandais, les Français, les Portugais et les Espagnols. De plus, la colonie de peuplement comme forme d’occupation de l’espace se trouve d’abord fondée sur un mode de production foncièrement agraire, en ce qu’elle vise l’établissement et l’enracinement de colons en vue d’un accaparement de la terre. Les occupants légitimes du sol, les Amérindiens seront d’ailleurs constamment repoussés vers l’Ouest, alors que leurs terres seront achetées, volées et pillées. Cette occupation de la terre entraînera donc une croissance économique assez rapide marquée par une poussée vers l’Ouest, généralement nommée la « seconde vague d’émigration ». De plus, la concentration progressive de populations dans les villes du Nord-Est et l’amélioration des moyens de production liés à la Révolution industrielle va favoriser le déploiement de nouveaux et nombreux pôles industriels. Ainsi, de grands centres industriels naîtront, principalement dans la zone maintenant connue sous le nom de Nouvelle-Angleterre. Cette poussée démographique modifiera profondément la structure de production du pays, alors marqué par deux phénomènes, l’esclavage et le travail libre. Par exemple :
« En 1790, moins d’un million d’Américains vivaient dans les villes. En 1840, ils sont onze millions. Entre 1820 et 1860, la population de New York passe de cent trente mille à un million d’habitants. [2]».
L’accroissement de population au niveau des milieux urbains est principalement attribuable aux fortes vagues d’immigration venues d’Europe, ce qui prouve bien que les États-Unis sont et demeurent une « colonie européenne » fort longtemps après leur indépendance politique de la Grande-Bretagne, survenue en 1776.
À cet égard, Marx est formel, il considère que la Révolution américaine n’a pas été réellement aboutie, ce qui reviendrait donc à dire que les États-Unis constituent toujours de fait une colonie de l’Angleterre, au moins au niveau de la production et de l’échange industriel. Dans les faits, cela est plausible étant donné que les rapports de production capitalistes, comme ceux d’Angleterre, vont souvent s’appuyer sur des rapports sociaux précapitalistes, tels ceux présents dans la zone Sud de l’Union. Il s’agit là d’un processus d’accumulation primitive classique, en ce que le capitalisme a dû pour consolider sa base mettre à profit des modes de production préexistants, tous précapitalistes. Marx fait ainsi remarquer que la principale activité économique en Angleterre dans les manufactures est la transformation du coton, en provenance de l’Amérique majoritairement des zones esclavagistes. Cela lui permettra d’ailleurs d’affirmer que :
« […] les fabricants de coton anglais […] s’appuyaient sur un double esclavage : l’esclavage indirect de l’homme blanc en Angleterre et l’esclavage direct de l’homme noir de l’autre côté de l’Atlantique.[3] »
Marx fait donc ici référence à l’esclavage salarié qui est vécu par les prolétaires anglais, ce que nous pourrions aussi nommer du servage volontaire. Il démontre clairement que le salariat britannique vient s’appuyer sur un mode de production précapitaliste lié à l’esclavage. Cela vient une fois de plus nous démontrer les liens tissés au sein même du colonialisme entre les colonies et le centre, généralement désigné de manière spécifique comme l’Empire. Évidemment, cette analyse est valide même si dans le cas du rapport entre les États-Unis et l’Angleterre il n’y a aucun lien formel ou institutionnel de domination, seulement des rapports d’échange, de production et d’exploitation économiques. Marx se fait encore plus clair lorsqu’il ajoute qu’:
« En somme, il fallait pour piédestal à l’esclavage dissimulé des salariés en Europe l’esclavage sans phrase dans le Nouveau Monde. [4]».
Cela montre donc que les différents modes de production, du moment où ils s’inscrivent dans le marché mondial vont devenir interconnectés, participant à un même travail continu. C’est ce réseau désormais mondial qui permet d’articuler entre eux les échanges les mettant en compétition afin de réaliser l’accumulation primitive.
Cependant, ce rapport entre colonialisme et impérialisme est progressivement en voir de changer alors que les États-Unis sont à cette époque en voie de supplanter l’Angleterre par une industrialisation accélérée. La prochaine nation impérialiste à récolter les fruits du marché mondial et à relever le flambeau d’un Empire britannique sur le déclin sera évidemment le « rival capitaliste » américain. Selon Marx, ce transfert qui se produira de l’Angleterre aux États-Unis d’Amérique est d’abord attribuable au facteur contingent de l’immigration massive des Irlandais sur la côte Est américaine. En effet, ces derniers sont contraints de s’expatrier en raison de la maladie de la pomme de terre, qui va ainsi entraîner un transfert de capital humain d’Irlande, alors sous la domination anglaise, jusque sur la côte Est, le tout dans des conditions misérables. Il s’agit là évidemment d’impondérables et nous pouvons affirmer qu’il est question aussi de la manière dont : « […] le capital naît, se développe, décline et meurt. [5]».
D’ailleurs, en ce qui concerne l’esclavage, ses principaux tenants forment une oligarchie d’environ trois cent milles propriétaires terriens, vivant pour l’extrême majorité au Sud de l’Union. C’est ainsi que ceux-ci, non contents de l’obtention de la légalité de l’esclavage dans leur région du pays, vont en plus tenter par divers moyens politiques de fonder l’esclavage comme institution nationale. C’est donc dire si l’esclavage comme rapport social doit, un peu à la manière du capitalisme, s’assurer d’une expansion territoriale continue pour assurer sa survivance. En ce sens, il est mémorable que: « […] les leaders du Sud ne se [soient] jamais fait d’illusion sur la nécessité absolue de maintenir leur hégémonie politique aux États-Unis. [6]». En effet, ils furent même les premiers à tenter de s’assurer que: « [l]a politique intérieure aussi bien qu’extérieure des États-Unis se mit au service des esclavagistes.[7] ». Sous la présidence de Buchanan, qui avait de fortes sympathies esclavagistes, la politique extérieure américaine fut adaptée en fonction du manifeste d’Ostende, qui fait référence au fait d’acheter aux Espagnols, voire même de prendre par les armes Cuba pour en faire une zone ouverte à l’esclavage.
Pour eux, cette hégémonie politique garantissait leur puissance économique, ce qui comptait en dernière instance. C’est pourquoi certaines prises de contrôle économique et politique furent décidées au Mexique, à La Grenade et au Nicaragua à cette époque. Il s’agit là évidemment d’une démarche et d’une conception des relations internationales proche de celle qui sera mise en application par les États impérialistes européens, plus particulièrement au cours de la décennie 1880. Nous tenterons maintenant de faire le lien entre les rapports de propriété public et privé.
Rapports de propriété public et privé
En ce qui concerne les rapports de propriété public et privé, il convient d’opérer d’abord certaines distinctions. Ainsi, la propriété publique, qu’elle soit communale ou étatique, a été préexistante à une appropriation privée du sol. Il est à noter que le type d’appropriation privée du sol peut prendre deux formes. Premièrement, il est possible que le fermier soit lui-même possesseur de sa propre terre, nous parlerons alors généralement des « hommes-libres », en ce sens qu’il exploite lui-même ses propres terres lui appartenant. Ensuite, le deuxième type d’appropriation privée prend une forme aliénée, en ce que la personne qui travaillera la terre le fera dorénavant pour le compte de quelqu’un d’autre, le tout contre salaire. Ce deuxième type de propriété privée est donc rendu possible à l’époque industrielle, après que la propriété collective ait été démantelée. Il permet aussi une appropriation privée des moyens de production.
Ce n’est donc pas pour rien si la propriété privée réclamée par les « free soilers » a été fortement limitée aux États-Unis. En effet, cette dernière entravait fortement le libre développement de l’industrie, qui manquait alors cruellement de main-d’œuvre, en maintenant une bonne proportion de fermiers dans un mode de production non-capitaliste. Ainsi, à un certain moment, les partisans de la terre libre se trouvèrent en compétition avec les esclavagistes quant à l’expansion et à la colonisation de l’Ouest du pays. Les premiers parvinrent même à faire voter « l’attribution gratuite de parcelles de terre libres dans l’Ouest considéré comme domaine d’État [propriété publique]. [8]».
C’était évidemment sans compter les nombreuses embûches légales qui furent posées afin de limiter la libre-accession à la propriété privée chez les colons. Par exemple, c’est dès 1854 que fut voté à la Chambre des représentants une loi sur la liberté du sol. Cependant, dès que cette loi vint en discussion au Sénat, elle fut battue par des Démocrates du Sud.
« Ce n’est qu’en 1860 qu’elle fut votée avec cette restriction cependant : la terre n’était pas attribuée gratuitement, mais contre paiement de vingt-cinq dollars par acre. Pourtant, le président Buchanan lui opposa son veto. [9]».
Il faudra alors attendre 1862 pour que cette loi soit finalement adoptée, suite à la victoire des Républicains et à la défaite du Sud. Il faut comprendre, à la suite de Marx que cette vente, par le gouvernement à un prix échappant à la loi de l’offre et de la demande, venait limiter énormément la possibilité pour un travailleur immigrant d’accéder à une propriété privée qui lui soit propre[10]. En effet, le coût, hautement prohibitif venait demander au moins quelques années de travail d’économie. Évidemment, cela obligeait les immigrants n’ayant pas accès à une fortune considérable à vendre leur travail contre salaire aux capitalistes industriels de la côte Est, au moins le temps d’amasser un capital suffisant… D’ailleurs, il peut être intéressant de mettre en parallèle cette extrême difficulté d’accessibilité à la propriété pour les simples travailleurs avec les grandes largesses concédées aux lignes de chemins de fer qui:
« [e]ntre 1850 et 1857 obtinrent quelque dix millions d’hectares de terrains publics exempts de loyers et des millions de dollars d’emprunts accordés par les législatures des États. [11]».
Évidemment, il s’agit là de la troisième force qui commençait à se faire entendre en ces années-là aux États-Unis, soit la future classe dirigeante, celle des capitalistes industriels. C’est donc dire si la classe capitaliste industrielle a pu bénéficier du support des différents États question de pousser plus en avant l’appropriation privée du sol et fonder à partir de cette terre son hégémonie future sur la nation américaine. C’est de cette manière qu’a été limitée une propriété privée qui aurait pu être bien différente.
Revenons maintenant aux partis esclavagistes et à leur stratégie de saisie de la nation tout entière. Ils tentèrent et réussirent même à faire porter un cas, le cas « Dred Scott » (Missouri, 1857), à la Cour suprême des États-Unis puis à aller y chercher un jugement favorable qui garantirait l’esclavage en fonction de la Constitution américaine[12]. Les juges de la Cour suprême, dont cinq sur neuf provenaient du Sud, reconnurent ainsi la légalité du transfert d’esclave d’un État à un autre. Les juges se basaient sur le fait que l‘esclave était alors considéré légalement comme un bien-meuble, donc de propriété privée, ce qui garantissait le libre usage que pouvait en faire son propriétaire constitutionnellement. Évidemment, cela incluait et garantissait son libre-mouvement, comme tout autre bien d’usage.
Cet argumentaire permettrait donc aux esclavagistes de payer certains de leurs membres pour aller s’établir dans des États comme le Nouveau-Mexique, et y instituer l’esclavage, le tout sans tenir compte du vote populaire de l’État en question. Le parti esclavagiste ne s’en cacha d’ailleurs pas en:
« […] [soutenant] que la Constitution des États-Unis – comme la Cour suprême l’avait déclaré- entraînait dans son sillage; en soi et pour soi, l’esclavage était déjà légal sur tout le territoire et n’exigeait aucune naturalisation particulière. [13]»
C’est là que le problème qui allait causer la Guerre civile se situait : dans cette interprétation trop étroite de la notion de propriété, dans la Constitution, par la Cour suprême. D’autant que cette décision venait remettre en question la valeur du Kansas-Nebraska Bill. Ce dernier devait être compris comme « la reconnaissance que la zone de l’esclavagisme était illimitée aux États-Unis. [14]». Cette dernière loi est considérée comme venant briser le compromis du Missouri, datant de 1820 et qui instaurait une ligne de démarcation entre les États esclavagistes et les non-esclavagistes. De plus pour l’admission des nouveaux États, alors simples territoires, il était prévu de s’en remettre à la « doctrine de la souveraineté populaire dans chaque État sur la question de l’introduction ou non de l’esclavage. [15]». Ce fut ce qui lança les hostilités au Kansas.
D’autant plus que de nombreuses fermes du Sud s’adonnaient maintenant à l’élevage d’esclaves dans le but de les revendre à d’autres esclavagistes et ainsi créer un nouveau marché intérieur… Et que le trafic d’esclaves qui avait été rendu illégal en 1808 se poursuivait toujours abondamment devant l’inaction des autorités.
À la conjonction entre la condition d’esclave et de celle d’homme libre, une troisième catégorie est donc née, soit celle du travailleur qui n’a que sa force de travail à vendre, du prolétaire. Ce dernier est en effet libre d’acquiescer à un contrat « librement consenti », « d’égal à égal », tel que qualifié par les économistes libéraux. Toute chose étant égale l’une par rapport à l’autre, le prolétaire n’en demeure pas moins obligé de reproduire sa propre force de travail, si ce n’est de se reproduire socialement. Il se trouve donc structurellement à la merci du donneur d’ouvrage, en ce qu’il ne possède par définition aucun capital pour l’appuyer dans une quelconque négociation salariale. À cet égard, il est possible pour nous de considérer l’esclavage comme une catégorie transitoire vers le capitalisme, vers le travail salarié, qui forme aussi probablement un mode de production tout aussi transitoire dans l’histoire de l’humanité. Nous allons maintenant tenter d’étudier les rapports entre ville et campagne dans le cadre de la Guerre civile américaine.
Rapports entre ville et campagne
Le conflit d’abord larvé puis plus tard officiellement déclaré entre le Nord et le Sud peut à juste titre être analysé comme un conflit entre deux modes de production différents. Ces deux modes étaient le mode de production agricole au Sud, basé sur l’institution de l’esclavage et le mode de production industriel du Nord basé sur le travail salarié et le capital privé (aliéné). Évidemment, c’est le système industriel du Nord qui permettait la création et la participation au grand marché mondial, par l’unité centrale du commerce et de la production. C’est d’ailleurs suite à l’organisation rationnelle et dominante de cette structure de circulation que la reproduction de la force de travail a pu être rendue possible. C’est donc par la production de valeurs d’usage grandissante que le bond qualitatif (et quantitatif) vers le capitalisme s’est opéré.
À ce moment, la production : « […] est le but de l’homme et la richesse le but de la production. [16]». La seconde face de la société capitaliste sera donc celle de l’organisation technique, scientifique et rationnelle du Travail Humain. La terre se trouvant à être le prolongement de l’homme, alors que propriété est défini comme:
« […] le comportement du sujet qui travaille […] à l’égard des conditions de sa production ou de sa reproduction, qu’il s’approprie. [17]».
C’est donc la propriété qui fait de l’homme un objet par rapport à la communauté humaine, pendant que la propriété privée, sous sa forme aliénée crée :
« [d]ans le monde bourgeois, [un] travailleur [qui] existe à l’état de sujet pur, dépourvu d’objet; mais l’objet qui lui fait face est devenu la vraie communauté, dont il cherche à se nourrir et qui s’en nourrit.[18] »
Par conséquent, le prolétaire se voit assujetti par rapport à la structure même de l’économie capitaliste, qui se nourrit de son surtravail. C’est d’ailleurs là directement ce que visent certaines lois qui cherchent à réglementer le passage vers le capitalisme industriel aux États-Unis. Il a aussi été fait référence plus tôt aux lois restreignant le libre accès à la propriété, en tant que régulation sociale, garantie par l’État fédéral et située hors du marché. Ce dernier État qui est lui-même fiduciaire des terres publiques supposé théoriquement viser le bien public et non l’enrichissement personnel. C’est donc suite à un bond qualitatif qui fit de la propriété publique, garantie par l’État américain, une propriété majoritairement privée que l’Amérique du Nord vit le mode de production capitaliste s’approprier le sol… et le pays. Ce dernier sera soumis à l’exploitation inégalée du Capital.
À la fin de la guerre de Sécession, dont le Nord industriel, urbanisé et capitaliste sortit victorieux du mode de production agraire, rural et pré-capitaliste du Sud fut défait et le système d’esclavage lentement démantelé. À sa place fut construit un régime d’occupation du territoire propre à combler les besoins en main-d’œuvre d’une société où le changement constituerait la seule constante pour les décennies à venir… Il s’agissait donc là aussi d’une victoire au chapitre de la division du travail de la ville sur la campagne, du Nord sur le Sud.
D’ailleurs, à ce propos, Marx vient aussi démontrer une fois de plus le caractère apatride du capital, alors qu’il définit New York, capitale économique du Nord-Est industriel victorieux comme :
« New York est au centre du compromis final entre le Sud et le Nord pour deux raisons: c’est le siège de la traite des esclaves, du marché de la monnaie, des capitaux et des créances hypothécaires des plantations du Sud, et ensuite l’intermédiaire de l’Angleterre. [19]».
La victoire du Nord sur le Sud vient donc fonder la victoire du mode de production capitaliste sur le mode de production précédent au niveau du territoire de tous les États-Unis. Il est bien clair par contre que le capital qui circule dès aux États-Unis provient d’une multitude d’endroits situés de par le territoire alors couvert par le marché mondial. L’état d’esclavage tel qu’elle se pratiquait au Sud se trouve donc:
« […] posé comme état historiquement dissous dans le rapport du travailleur aux conditions de production en tant que capital. [20]».
En définitive, il reste clair que le capital circulatoire s’est vu transférer en grande partie de Londres vers New York, alors qu’il avait auparavant été transféré de même en partant de Venise et de Gênes, en passant par Amsterdam, pôle du capitalisme marchand pour aboutir à Londres. Cette ville, bien que capitale mondiale du commerce et du marché ne parvenait pas même à nourrir sa propre population laborieuse et véritable créatrice de richesse. C’est donc la preuve scientifique selon Marx, qui détourne Adam Smith que la richesse des nations est synonyme de pauvreté des peuples, c’est à dire fait abstraction des quelques éléments spéculateurs et possesseurs privés des moyens de production. Le capital n’en reste pas tout aussi amoral, apatride et asocial…
« Le capital abhorre l’absence de profit […] comme la nature a horreur du vide. […] Quand le désordre et la discorde portent profit, il les encourage tous deux; preuve : la contrebande et la traite des nègres.[21] ».
Bibliographie :
- ENGELS, Friedrich et MARX, Karl. La guerre civile aux États-Unis, Union Générale d’Éditions, Paris, 1970, 315 p.
- Le Nouvel Observateur. Karl Marx: le penseur du troisième millénaire ?, Octobre-décembre 2003, 99 p.
- MARX, Karl. « Chapitre XXIX-XXXIII » dans Le Capital section V à VIII, Éditions Flammarion, Paris, 1985, p. 190-215.
- MARX, Karl. L’idéologie allemande, Éditions sociales, 1972, p. 1069-1125.
- MARX, Karl. Principes d’une critique de l’économie politique, Éditions sociales, 1857, p. 312-359.
- ZINN, Howard. « L’autre guerre civile » in Une histoire populaire des États-Unis : de 1492 à nos jours, Éditions Agone / Lux, Paris, Montréal, 2002, p. 245-291.
[1] Lincoln est aussi celui qui fit suspendre l’habeas corpus lors de la Guerre de Sécession américaine
[2] ZINN, Howard. « L’autre guerre civile » in Une histoire populaire des États-Unis : de 1492 à nos jours, Éditions Agone / Lux, Paris, Montréal, 2002, p. 253.
[3] ENGELS, Friedrich et MARX, Karl. La guerre civile aux États-Unis, Union Générale d’Éditions, Paris, 1970, p. 58.
[4] MARX, Karl. « Chapitre XXXI » dans Le Capital section V à VIII, Éditions Flammarion, Paris, 1985, p. 204.
[5] ENGELS, Friedrich et MARX, Karl. La guerre civile aux États-Unis, Union Générale d’Éditions, Paris, 1970, p. 261.
6 Ibid, p. 33.
7 Ibid, p. 45.
[8] ENGELS, Friedrich et MARX, Karl. La guerre civile aux États-Unis, Union Générale d’Éditions, Paris, 1970, p. 257.
[9] ENGELS, Friedrich et MARX, Karl. La guerre civile aux États-Unis, Union Générale d’Éditions, Paris, 1970, p. 258.
[10] MARX, Karl. « Chapitre XXXIII » dans Le Capital section V à VIII, Éditions Flammarion, Paris, 1985, p. 213.
[11] ZINN, Howard. « L’autre guerre civile » in Une histoire populaire des États-Unis : de 1492 à nos jours, Éditions Agone / Lux, Paris, Montréal, 2002, p. 253.
[12] ENGELS, Friedrich et MARX, Karl. La guerre civile aux États-Unis, Union Générale d’Éditions, Paris, 1970, p. 43-44.
[13] Ibid, p. 51.
[14] Ibid, p. 251.
[15] Ibid.
[16] MARX, Karl. Principes d’une critique de l’économie politique, Éditions sociales, 1857, p. 327.
[17] Ibid, p. 337.
[18] Ibid, p. 338.
[19] ENGELS, Friedrich et MARX, Karl. La guerre civile aux États-Unis, Union Générale d’Éditions, Paris, 1970, p. 262.
[20] MARX, Karl. Principes d’une critique de l’économie politique, Éditions sociales, 1857, p. 342.
[21] MARX, Karl. « Notes, Chapitre XXXI » dans Le Capital section V à VIII, Éditions Flammarion, Paris, 1985, p. 259.
« On peut tromper tout le monde pendant un certain temps et certains pour toujours, mais on ne peut tromper tout le monde éternellement »
Abraham Lincoln[1]
Contrairement à l’image communément véhiculée qui fait de Karl Marx un observateur de situations essentiellement européennes, ce dernier a su être un témoin privilégié de la situation politique précédant la Guerre civile aux États-Unis. En effet, il a pu observer de près le climat de tension, les bases de celui-ci, et le développement d’un climat de guerre civile en terre d’Amérique, qui se développait entre le Nord et le Sud de l’Union. Marx, qui dépouillait aussi les journaux d’outre-Atlantique, qu’ils soient anglais, français voire même russe en profitait même pour écrire certaines chroniques à l’attention de journaux américains tels le New York Daily Tribune. Il se prêtait aussi au jeu pour le compte de journaux allemands comme le Die Presse, en plus d’entretenir une correspondance soutenue avec son collaborateur Friedrich Engels. L’objet du travail consistera en une étude critique de l’ouvrage La guerre civile aux Etats-Unis de Marx et d’Engels. Il est à noter que les écrits militaires rédigés avec l’aide d’Engels n’ont pas été retenus pour les fins de l’étude, qui portera plutôt sur l’évolution des facteurs économiques et politiques dans l’étude qu’en fait Marx. Nous aborderons donc en premier lieu le rapport développé tout au long des textes de Marx entre le colonialisme et puis l’impérialisme. En second lieu, nous traiterons de la question de la propriété, plus particulièrement du rapport entretenu entre la propriété publique et la propriété privée, dans le développement du capitalisme en terre des États-Unis d’Amérique. Enfin, il sera possible de développer sur la distinction entre la ville et la campagne, le tout évidemment dans le cadre d’une analyse centrée sur la rupture entre deux modes de production différents, soit le mode de production agraire, extensif et précapitaliste du Sud et le mode de production industriel, intensif et capitaliste propre au Nord de l’Union américaine.
Rapports entre colonialisme et impérialisme
Colonialisme en Amérique du Nord
En tout premier lieu, les origines coloniales des États-Unis d’Amérique apparaissent comme importantes si l’on veut saisir tous les soubresauts de leur histoire. Ainsi, la colonie américaine sera ouverte sur la côte Est et d’abord développée comme une colonie de peuplement par les Britanniques. Ce mode de développement s’oppose bien entendu à un développement de colonie-comptoir plus propre à l’émergence d’un capitalisme marchand fondé sur l’échange, tels qu’ont pu le pratiquer par exemple les Hollandais, les Français, les Portugais et les Espagnols. De plus, la colonie de peuplement comme forme d’occupation de l’espace se trouve d’abord fondée sur un mode de production foncièrement agraire, en ce qu’elle vise l’établissement et l’enracinement de colons en vue d’un accaparement de la terre. Les occupants légitimes du sol, les Amérindiens seront d’ailleurs constamment repoussés vers l’Ouest, alors que leurs terres seront achetées, volées et pillées. Cette occupation de la terre entraînera donc une croissance économique assez rapide marquée par une poussée vers l’Ouest, généralement nommée la « seconde vague d’émigration ». De plus, la concentration progressive de populations dans les villes du Nord-Est et l’amélioration des moyens de production liés à la Révolution industrielle va favoriser le déploiement de nouveaux et nombreux pôles industriels. Ainsi, de grands centres industriels naîtront, principalement dans la zone maintenant connue sous le nom de Nouvelle-Angleterre. Cette poussée démographique modifiera profondément la structure de production du pays, alors marqué par deux phénomènes, l’esclavage et le travail libre. Par exemple :
« En 1790, moins d’un million d’Américains vivaient dans les villes. En 1840, ils sont onze millions. Entre 1820 et 1860, la population de New York passe de cent trente mille à un million d’habitants. [2]».
L’accroissement de population au niveau des milieux urbains est principalement attribuable aux fortes vagues d’immigration venues d’Europe, ce qui prouve bien que les États-Unis sont et demeurent une « colonie européenne » fort longtemps après leur indépendance politique de la Grande-Bretagne, survenue en 1776.
À cet égard, Marx est formel, il considère que la Révolution américaine n’a pas été réellement aboutie, ce qui reviendrait donc à dire que les États-Unis constituent toujours de fait une colonie de l’Angleterre, au moins au niveau de la production et de l’échange industriel. Dans les faits, cela est plausible étant donné que les rapports de production capitalistes, comme ceux d’Angleterre, vont souvent s’appuyer sur des rapports sociaux précapitalistes, tels ceux présents dans la zone Sud de l’Union. Il s’agit là d’un processus d’accumulation primitive classique, en ce que le capitalisme a dû pour consolider sa base mettre à profit des modes de production préexistants, tous précapitalistes. Marx fait ainsi remarquer que la principale activité économique en Angleterre dans les manufactures est la transformation du coton, en provenance de l’Amérique majoritairement des zones esclavagistes. Cela lui permettra d’ailleurs d’affirmer que :
« […] les fabricants de coton anglais […] s’appuyaient sur un double esclavage : l’esclavage indirect de l’homme blanc en Angleterre et l’esclavage direct de l’homme noir de l’autre côté de l’Atlantique.[3] »
Marx fait donc ici référence à l’esclavage salarié qui est vécu par les prolétaires anglais, ce que nous pourrions aussi nommer du servage volontaire. Il démontre clairement que le salariat britannique vient s’appuyer sur un mode de production précapitaliste lié à l’esclavage. Cela vient une fois de plus nous démontrer les liens tissés au sein même du colonialisme entre les colonies et le centre, généralement désigné de manière spécifique comme l’Empire. Évidemment, cette analyse est valide même si dans le cas du rapport entre les États-Unis et l’Angleterre il n’y a aucun lien formel ou institutionnel de domination, seulement des rapports d’échange, de production et d’exploitation économiques. Marx se fait encore plus clair lorsqu’il ajoute qu’:
« En somme, il fallait pour piédestal à l’esclavage dissimulé des salariés en Europe l’esclavage sans phrase dans le Nouveau Monde. [4]».
Cela montre donc que les différents modes de production, du moment où ils s’inscrivent dans le marché mondial vont devenir interconnectés, participant à un même travail continu. C’est ce réseau désormais mondial qui permet d’articuler entre eux les échanges les mettant en compétition afin de réaliser l’accumulation primitive.
Cependant, ce rapport entre colonialisme et impérialisme est progressivement en voir de changer alors que les États-Unis sont à cette époque en voie de supplanter l’Angleterre par une industrialisation accélérée. La prochaine nation impérialiste à récolter les fruits du marché mondial et à relever le flambeau d’un Empire britannique sur le déclin sera évidemment le « rival capitaliste » américain. Selon Marx, ce transfert qui se produira de l’Angleterre aux États-Unis d’Amérique est d’abord attribuable au facteur contingent de l’immigration massive des Irlandais sur la côte Est américaine. En effet, ces derniers sont contraints de s’expatrier en raison de la maladie de la pomme de terre, qui va ainsi entraîner un transfert de capital humain d’Irlande, alors sous la domination anglaise, jusque sur la côte Est, le tout dans des conditions misérables. Il s’agit là évidemment d’impondérables et nous pouvons affirmer qu’il est question aussi de la manière dont : « […] le capital naît, se développe, décline et meurt. [5]».
D’ailleurs, en ce qui concerne l’esclavage, ses principaux tenants forment une oligarchie d’environ trois cent milles propriétaires terriens, vivant pour l’extrême majorité au Sud de l’Union. C’est ainsi que ceux-ci, non contents de l’obtention de la légalité de l’esclavage dans leur région du pays, vont en plus tenter par divers moyens politiques de fonder l’esclavage comme institution nationale. C’est donc dire si l’esclavage comme rapport social doit, un peu à la manière du capitalisme, s’assurer d’une expansion territoriale continue pour assurer sa survivance. En ce sens, il est mémorable que: « […] les leaders du Sud ne se [soient] jamais fait d’illusion sur la nécessité absolue de maintenir leur hégémonie politique aux États-Unis. [6]». En effet, ils furent même les premiers à tenter de s’assurer que: « [l]a politique intérieure aussi bien qu’extérieure des États-Unis se mit au service des esclavagistes.[7] ». Sous la présidence de Buchanan, qui avait de fortes sympathies esclavagistes, la politique extérieure américaine fut adaptée en fonction du manifeste d’Ostende, qui fait référence au fait d’acheter aux Espagnols, voire même de prendre par les armes Cuba pour en faire une zone ouverte à l’esclavage.
Pour eux, cette hégémonie politique garantissait leur puissance économique, ce qui comptait en dernière instance. C’est pourquoi certaines prises de contrôle économique et politique furent décidées au Mexique, à La Grenade et au Nicaragua à cette époque. Il s’agit là évidemment d’une démarche et d’une conception des relations internationales proche de celle qui sera mise en application par les États impérialistes européens, plus particulièrement au cours de la décennie 1880. Nous tenterons maintenant de faire le lien entre les rapports de propriété public et privé.
Rapports de propriété public et privé
En ce qui concerne les rapports de propriété public et privé, il convient d’opérer d’abord certaines distinctions. Ainsi, la propriété publique, qu’elle soit communale ou étatique, a été préexistante à une appropriation privée du sol. Il est à noter que le type d’appropriation privée du sol peut prendre deux formes. Premièrement, il est possible que le fermier soit lui-même possesseur de sa propre terre, nous parlerons alors généralement des « hommes-libres », en ce sens qu’il exploite lui-même ses propres terres lui appartenant. Ensuite, le deuxième type d’appropriation privée prend une forme aliénée, en ce que la personne qui travaillera la terre le fera dorénavant pour le compte de quelqu’un d’autre, le tout contre salaire. Ce deuxième type de propriété privée est donc rendu possible à l’époque industrielle, après que la propriété collective ait été démantelée. Il permet aussi une appropriation privée des moyens de production.
Ce n’est donc pas pour rien si la propriété privée réclamée par les « free soilers » a été fortement limitée aux États-Unis. En effet, cette dernière entravait fortement le libre développement de l’industrie, qui manquait alors cruellement de main-d’œuvre, en maintenant une bonne proportion de fermiers dans un mode de production non-capitaliste. Ainsi, à un certain moment, les partisans de la terre libre se trouvèrent en compétition avec les esclavagistes quant à l’expansion et à la colonisation de l’Ouest du pays. Les premiers parvinrent même à faire voter « l’attribution gratuite de parcelles de terre libres dans l’Ouest considéré comme domaine d’État [propriété publique]. [8]».
C’était évidemment sans compter les nombreuses embûches légales qui furent posées afin de limiter la libre-accession à la propriété privée chez les colons. Par exemple, c’est dès 1854 que fut voté à la Chambre des représentants une loi sur la liberté du sol. Cependant, dès que cette loi vint en discussion au Sénat, elle fut battue par des Démocrates du Sud.
« Ce n’est qu’en 1860 qu’elle fut votée avec cette restriction cependant : la terre n’était pas attribuée gratuitement, mais contre paiement de vingt-cinq dollars par acre. Pourtant, le président Buchanan lui opposa son veto. [9]».
Il faudra alors attendre 1862 pour que cette loi soit finalement adoptée, suite à la victoire des Républicains et à la défaite du Sud. Il faut comprendre, à la suite de Marx que cette vente, par le gouvernement à un prix échappant à la loi de l’offre et de la demande, venait limiter énormément la possibilité pour un travailleur immigrant d’accéder à une propriété privée qui lui soit propre[10]. En effet, le coût, hautement prohibitif venait demander au moins quelques années de travail d’économie. Évidemment, cela obligeait les immigrants n’ayant pas accès à une fortune considérable à vendre leur travail contre salaire aux capitalistes industriels de la côte Est, au moins le temps d’amasser un capital suffisant… D’ailleurs, il peut être intéressant de mettre en parallèle cette extrême difficulté d’accessibilité à la propriété pour les simples travailleurs avec les grandes largesses concédées aux lignes de chemins de fer qui:
« [e]ntre 1850 et 1857 obtinrent quelque dix millions d’hectares de terrains publics exempts de loyers et des millions de dollars d’emprunts accordés par les législatures des États. [11]».
Évidemment, il s’agit là de la troisième force qui commençait à se faire entendre en ces années-là aux États-Unis, soit la future classe dirigeante, celle des capitalistes industriels. C’est donc dire si la classe capitaliste industrielle a pu bénéficier du support des différents États question de pousser plus en avant l’appropriation privée du sol et fonder à partir de cette terre son hégémonie future sur la nation américaine. C’est de cette manière qu’a été limitée une propriété privée qui aurait pu être bien différente.
Revenons maintenant aux partis esclavagistes et à leur stratégie de saisie de la nation tout entière. Ils tentèrent et réussirent même à faire porter un cas, le cas « Dred Scott » (Missouri, 1857), à la Cour suprême des États-Unis puis à aller y chercher un jugement favorable qui garantirait l’esclavage en fonction de la Constitution américaine[12]. Les juges de la Cour suprême, dont cinq sur neuf provenaient du Sud, reconnurent ainsi la légalité du transfert d’esclave d’un État à un autre. Les juges se basaient sur le fait que l‘esclave était alors considéré légalement comme un bien-meuble, donc de propriété privée, ce qui garantissait le libre usage que pouvait en faire son propriétaire constitutionnellement. Évidemment, cela incluait et garantissait son libre-mouvement, comme tout autre bien d’usage.
Cet argumentaire permettrait donc aux esclavagistes de payer certains de leurs membres pour aller s’établir dans des États comme le Nouveau-Mexique, et y instituer l’esclavage, le tout sans tenir compte du vote populaire de l’État en question. Le parti esclavagiste ne s’en cacha d’ailleurs pas en:
« […] [soutenant] que la Constitution des États-Unis – comme la Cour suprême l’avait déclaré- entraînait dans son sillage; en soi et pour soi, l’esclavage était déjà légal sur tout le territoire et n’exigeait aucune naturalisation particulière. [13]»
C’est là que le problème qui allait causer la Guerre civile se situait : dans cette interprétation trop étroite de la notion de propriété, dans la Constitution, par la Cour suprême. D’autant que cette décision venait remettre en question la valeur du Kansas-Nebraska Bill. Ce dernier devait être compris comme « la reconnaissance que la zone de l’esclavagisme était illimitée aux États-Unis. [14]». Cette dernière loi est considérée comme venant briser le compromis du Missouri, datant de 1820 et qui instaurait une ligne de démarcation entre les États esclavagistes et les non-esclavagistes. De plus pour l’admission des nouveaux États, alors simples territoires, il était prévu de s’en remettre à la « doctrine de la souveraineté populaire dans chaque État sur la question de l’introduction ou non de l’esclavage. [15]». Ce fut ce qui lança les hostilités au Kansas.
D’autant plus que de nombreuses fermes du Sud s’adonnaient maintenant à l’élevage d’esclaves dans le but de les revendre à d’autres esclavagistes et ainsi créer un nouveau marché intérieur… Et que le trafic d’esclaves qui avait été rendu illégal en 1808 se poursuivait toujours abondamment devant l’inaction des autorités.
À la conjonction entre la condition d’esclave et de celle d’homme libre, une troisième catégorie est donc née, soit celle du travailleur qui n’a que sa force de travail à vendre, du prolétaire. Ce dernier est en effet libre d’acquiescer à un contrat « librement consenti », « d’égal à égal », tel que qualifié par les économistes libéraux. Toute chose étant égale l’une par rapport à l’autre, le prolétaire n’en demeure pas moins obligé de reproduire sa propre force de travail, si ce n’est de se reproduire socialement. Il se trouve donc structurellement à la merci du donneur d’ouvrage, en ce qu’il ne possède par définition aucun capital pour l’appuyer dans une quelconque négociation salariale. À cet égard, il est possible pour nous de considérer l’esclavage comme une catégorie transitoire vers le capitalisme, vers le travail salarié, qui forme aussi probablement un mode de production tout aussi transitoire dans l’histoire de l’humanité. Nous allons maintenant tenter d’étudier les rapports entre ville et campagne dans le cadre de la Guerre civile américaine.
Rapports entre ville et campagne
Le conflit d’abord larvé puis plus tard officiellement déclaré entre le Nord et le Sud peut à juste titre être analysé comme un conflit entre deux modes de production différents. Ces deux modes étaient le mode de production agricole au Sud, basé sur l’institution de l’esclavage et le mode de production industriel du Nord basé sur le travail salarié et le capital privé (aliéné). Évidemment, c’est le système industriel du Nord qui permettait la création et la participation au grand marché mondial, par l’unité centrale du commerce et de la production. C’est d’ailleurs suite à l’organisation rationnelle et dominante de cette structure de circulation que la reproduction de la force de travail a pu être rendue possible. C’est donc par la production de valeurs d’usage grandissante que le bond qualitatif (et quantitatif) vers le capitalisme s’est opéré.
À ce moment, la production : « […] est le but de l’homme et la richesse le but de la production. [16]». La seconde face de la société capitaliste sera donc celle de l’organisation technique, scientifique et rationnelle du Travail Humain. La terre se trouvant à être le prolongement de l’homme, alors que propriété est défini comme:
« […] le comportement du sujet qui travaille […] à l’égard des conditions de sa production ou de sa reproduction, qu’il s’approprie. [17]».
C’est donc la propriété qui fait de l’homme un objet par rapport à la communauté humaine, pendant que la propriété privée, sous sa forme aliénée crée :
« [d]ans le monde bourgeois, [un] travailleur [qui] existe à l’état de sujet pur, dépourvu d’objet; mais l’objet qui lui fait face est devenu la vraie communauté, dont il cherche à se nourrir et qui s’en nourrit.[18] »
Par conséquent, le prolétaire se voit assujetti par rapport à la structure même de l’économie capitaliste, qui se nourrit de son surtravail. C’est d’ailleurs là directement ce que visent certaines lois qui cherchent à réglementer le passage vers le capitalisme industriel aux États-Unis. Il a aussi été fait référence plus tôt aux lois restreignant le libre accès à la propriété, en tant que régulation sociale, garantie par l’État fédéral et située hors du marché. Ce dernier État qui est lui-même fiduciaire des terres publiques supposé théoriquement viser le bien public et non l’enrichissement personnel. C’est donc suite à un bond qualitatif qui fit de la propriété publique, garantie par l’État américain, une propriété majoritairement privée que l’Amérique du Nord vit le mode de production capitaliste s’approprier le sol… et le pays. Ce dernier sera soumis à l’exploitation inégalée du Capital.
À la fin de la guerre de Sécession, dont le Nord industriel, urbanisé et capitaliste sortit victorieux du mode de production agraire, rural et pré-capitaliste du Sud fut défait et le système d’esclavage lentement démantelé. À sa place fut construit un régime d’occupation du territoire propre à combler les besoins en main-d’œuvre d’une société où le changement constituerait la seule constante pour les décennies à venir… Il s’agissait donc là aussi d’une victoire au chapitre de la division du travail de la ville sur la campagne, du Nord sur le Sud.
D’ailleurs, à ce propos, Marx vient aussi démontrer une fois de plus le caractère apatride du capital, alors qu’il définit New York, capitale économique du Nord-Est industriel victorieux comme :
« New York est au centre du compromis final entre le Sud et le Nord pour deux raisons: c’est le siège de la traite des esclaves, du marché de la monnaie, des capitaux et des créances hypothécaires des plantations du Sud, et ensuite l’intermédiaire de l’Angleterre. [19]».
La victoire du Nord sur le Sud vient donc fonder la victoire du mode de production capitaliste sur le mode de production précédent au niveau du territoire de tous les États-Unis. Il est bien clair par contre que le capital qui circule dès aux États-Unis provient d’une multitude d’endroits situés de par le territoire alors couvert par le marché mondial. L’état d’esclavage tel qu’elle se pratiquait au Sud se trouve donc:
« […] posé comme état historiquement dissous dans le rapport du travailleur aux conditions de production en tant que capital. [20]».
En définitive, il reste clair que le capital circulatoire s’est vu transférer en grande partie de Londres vers New York, alors qu’il avait auparavant été transféré de même en partant de Venise et de Gênes, en passant par Amsterdam, pôle du capitalisme marchand pour aboutir à Londres. Cette ville, bien que capitale mondiale du commerce et du marché ne parvenait pas même à nourrir sa propre population laborieuse et véritable créatrice de richesse. C’est donc la preuve scientifique selon Marx, qui détourne Adam Smith que la richesse des nations est synonyme de pauvreté des peuples, c’est à dire fait abstraction des quelques éléments spéculateurs et possesseurs privés des moyens de production. Le capital n’en reste pas tout aussi amoral, apatride et asocial…
« Le capital abhorre l’absence de profit […] comme la nature a horreur du vide. […] Quand le désordre et la discorde portent profit, il les encourage tous deux; preuve : la contrebande et la traite des nègres.[21] ».
Bibliographie :
- ENGELS, Friedrich et MARX, Karl. La guerre civile aux États-Unis, Union Générale d’Éditions, Paris, 1970, 315 p.
- Le Nouvel Observateur. Karl Marx: le penseur du troisième millénaire ?, Octobre-décembre 2003, 99 p.
- MARX, Karl. « Chapitre XXIX-XXXIII » dans Le Capital section V à VIII, Éditions Flammarion, Paris, 1985, p. 190-215.
- MARX, Karl. L’idéologie allemande, Éditions sociales, 1972, p. 1069-1125.
- MARX, Karl. Principes d’une critique de l’économie politique, Éditions sociales, 1857, p. 312-359.
- ZINN, Howard. « L’autre guerre civile » in Une histoire populaire des États-Unis : de 1492 à nos jours, Éditions Agone / Lux, Paris, Montréal, 2002, p. 245-291.
[1] Lincoln est aussi celui qui fit suspendre l’habeas corpus lors de la Guerre de Sécession américaine
[2] ZINN, Howard. « L’autre guerre civile » in Une histoire populaire des États-Unis : de 1492 à nos jours, Éditions Agone / Lux, Paris, Montréal, 2002, p. 253.
[3] ENGELS, Friedrich et MARX, Karl. La guerre civile aux États-Unis, Union Générale d’Éditions, Paris, 1970, p. 58.
[4] MARX, Karl. « Chapitre XXXI » dans Le Capital section V à VIII, Éditions Flammarion, Paris, 1985, p. 204.
[5] ENGELS, Friedrich et MARX, Karl. La guerre civile aux États-Unis, Union Générale d’Éditions, Paris, 1970, p. 261.
6 Ibid, p. 33.
7 Ibid, p. 45.
[8] ENGELS, Friedrich et MARX, Karl. La guerre civile aux États-Unis, Union Générale d’Éditions, Paris, 1970, p. 257.
[9] ENGELS, Friedrich et MARX, Karl. La guerre civile aux États-Unis, Union Générale d’Éditions, Paris, 1970, p. 258.
[10] MARX, Karl. « Chapitre XXXIII » dans Le Capital section V à VIII, Éditions Flammarion, Paris, 1985, p. 213.
[11] ZINN, Howard. « L’autre guerre civile » in Une histoire populaire des États-Unis : de 1492 à nos jours, Éditions Agone / Lux, Paris, Montréal, 2002, p. 253.
[12] ENGELS, Friedrich et MARX, Karl. La guerre civile aux États-Unis, Union Générale d’Éditions, Paris, 1970, p. 43-44.
[13] Ibid, p. 51.
[14] Ibid, p. 251.
[15] Ibid.
[16] MARX, Karl. Principes d’une critique de l’économie politique, Éditions sociales, 1857, p. 327.
[17] Ibid, p. 337.
[18] Ibid, p. 338.
[19] ENGELS, Friedrich et MARX, Karl. La guerre civile aux États-Unis, Union Générale d’Éditions, Paris, 1970, p. 262.
[20] MARX, Karl. Principes d’une critique de l’économie politique, Éditions sociales, 1857, p. 342.
[21] MARX, Karl. « Notes, Chapitre XXXI » dans Le Capital section V à VIII, Éditions Flammarion, Paris, 1985, p. 259.
dimanche, octobre 03, 2004

Jacques était là dans son salon, écoutant la musique évoquant chez lui un semblant de messe enchanté par le son d’un Casavant. Dans son trois et demi, les murs du salon trop grands ternissaient les couleurs de son pantalon. Un pantalon rouge nananne, dont il avait fait l’acquisition à l’une des merceries du faubourg, lequel lui imposait la cadence. Pourquoi s’en plaindre? Ce pantalon le mettait à l’aise au premier abord et il ne le portait qu’à la maison. Tenant dans sa main droite une copie d’un journal, l’encre séché lui donnant la sensation d’égriser les pores de sa paume. Le tenant roulé, il le serait tel le volant d’une voiture dont il n’avait pas les moyens.
Habituellement, l’heure et la date avaient une importance pour lui, il cherchait à savoir ce qui se produisait ailleurs que chez lui. À son habitude, ses choses ne bougeaient pas. Il en avait l’impression. Reste t’il que les choses qui ne bougent pas n’étaient, vraisemblablement, pas, à son avis. À cette constatation lui vint à l’esprit la question à savoir si réellement lui-même était un objet dont l’existence eidétique prenait place. Levant les yeux vers son buste d’Hérode, il y vit les égratignures de son chat mort, il y a de cela 2 mois. L’absence d’Oscar se sentait encore. Jacques ne vivait plus avec cette odeur de litière et ses vêtements s’étaient émaciés de la masse des poils perdus par le félin, mort d’une crise d’hormones.
Beaucoup de détails en si peu de temps, la vitesse de la pensée en fonction des mains et de la vue font fondre l’envie de perdurer la teneur du propos. Affranchi de sa cage sociale, Jacques ne cherche pas à s’en sortir. La liberté est impitoyable pour ceux dont la créativité et le respect des lois sont cuit à point. Pourquoi ne pas être l’un de ces fouilles-merdes de journalistes? Aller fouler le terrain, être exhaustif des faits cuculs de la vie serait tellement plus pressant. Être pressé, oui, une semaine n’attendrait pas l’autre! Repaver les quartiers Est, les rendre intéressants, y emmener les yuppies et vaincre la pauvreté. Le relief de ma vie deviendrait celui d’une star.
La réluctance vient faire son tour. Eh merde! La présomption ne sert à rien pour celui dont le lustre s’est perdu, même pour ceux allant encore d’un hourvari. Jacques comprit qu’il était entrain à se compromettre dans sa relative espérance de vie. Il y a deux semaines de cela, il dévisageait le scintillement de son ouvre-lettre ougandais. L’éclat rouge des rideaux à travers duquel venait se poser une fine lame de lumière atterrissait directement sur son tranchant. La poignée faite d’ivoire donnait l’argument à l’acte d’être de bon goût, un suicide succulent. Puis aujourd’hui, il vit la corde servant à tenir les rideaux spartiates. D’un bond du regard, un calcul mathématique s’entreprit à faire le test de résistance entre la corde sa masse et le point d’attache. La corde, elle aussi ayant de la classe, était dorée et épaisse. Il restait tout de même à se trouver un point d’attache assez solide. Aucune poutre, clou ou garde-robe était assez robuste. Le buste de Jacques se bomba et il relâcha son souffle. À quoi bon, le suicide n’est qu’une solution afin de mettre fin à sa vie. Il serait bien plus simple d’arrêter d’être conscient du fait de son vécu. Il regarda le journal et l’ouvrit, un bon début. Les grands titres se précipitant à proximité des publicités, il vit.
Posted by Hello

Réflexion d’un exilé de l’université…
l’évidence des faits, je m’aperçois qu’il existe un certain rapport de jouissance dans la perte d’enthousiasme causé chez celui ou celle qu’on méprise. À cet exercice cognitif m’aspire la pensée suivante, les cours universitaires et les rapports s’y écoulant en sont de ceux qui ressemblent au désir sexuel des pervers. Allant y rechercher des émotions fortes, certains d’entre vous, tout comme moi, se masturbe le cerveau. Certains y font un exercice de style, renouvelant la prise de l’objet à des fins d’y maximiser l’effet de profit. Une masturbation, s’affranchissant de sa cage sociale, qui mène son troupeau vers le rendurcissement de son identité : celui d’être le partenaire des uns et des autres et ce en lui crachant au visage. « Suis-je à l’aise à me suicider socialement? Oui.» À mon exil de votre enclos, je m’aperçois que mes frustrations se sont évincés. D’autre part, j’y vois que certains y vont d’une complaisance terrible à l’enchaînement de leurs âmes au tronc du corps professoral. Le savoir c’est comme l’argent, plus vous en avez et plus vous voulez en avoir pour le faire profiter. À ce regard dans l’abîme, j’y vois un reflet qui me dégoûte. Derrière moi, y sont ceux que j’ai côtoyés et qui dans le post-succès des grandes épreuves en viennent à se trahir. À savoir que lorsqu’il n’y a plus d’ennemi, cette haine se retourne contre soi. Fruit des anti-révolutions, qu’il s’agit de combattre l’hypocrisie des uns, les autres deviennent ces mêmes hypocrites. Une auto-satisfaction sexué, car le sexe est en soi plus fort que lorsque intime.
Il a agi avec bravoure.
Posted by Hello

Dans quel sens peut-on parler de portée internationale de la révolution russe ? Pendant les premiers mois qui suivirent la conquête du pouvoir politique par le prolétariat en Russie (25 octobre - 7 novembre
1917), il pouvait sembler que les différences très marquées entre ce pays arriéré et les pays avancés d'Europe occidentale y rendraient la révolution du prolétariat très différentes de la nôtre. Aujourd'hui nous avons par devers nous une expérience internationale fort appréciable, qui atteste de toute évidence que certains traits essentiels de notre révolution n'ont pas une portée locale, ni particulièrement nationale, ni uniquement russe, mais bien internationale. Et je ne parle pas ici de la portée internationale au sens large du mot : il ne s'agit pas de certains traits, mais tous les traits
essentiels et aussi certains traits secondaires de notre révolution ont une portée internationale, en ce sens qu'elle exerce une action sur tous les pays. Non, c'est dans le sens le plus étroit du mot, c'est à dire en entendant par portée internationale la valeur internationale ou la répétition historique inévitable, à l'échelle internationale, de ce qui c'est passé chez nous, que certains traits essentiels ont cette portée.
Certes, on aurait grandement tort d'exagérer cette vérité, de l'entendre au-delà de certains traits essentiels de notre révolution. On aurait également tort de perdre de vue qu'après la victoire de la révolution prolétarienne, si même elle n'a lieu que dans un seul des pays avancés, il se produira, selon toute probabilité, un brusque changement, à savoir : la Russie redeviendra, bientôt après, un pays, non plus exemplaire, mais retardataire (au point de vue "soviétique" et socialiste).
Mais en ce moment de l'histoire, les choses se présentent ainsi : l'exemple russe montre à tous les pays quelque chose de tout à fait essentiel, de leur inévitable et prochain avenir. Les ouvriers avancés de tous les pays l'ont compris depuis longtemps, mais le plus souvent ils ne l'ont pas tant compris que pressenti avec leur instinct de classe révolutionnaire.
D'où la "portée" internationale (au sens étroit du mot) du pouvoir des Soviets, et aussi des principes de la théorie et de la tactique bolcheviques. Voilà ce que n'ont pas compris les chefs "révolutionnaires" de la II° Internationale, tels que Kautsky en Allemagne, Otto Bauer et Friedrich Adler en Autriche, qui, pour cette raison, se sont révélés des réactionnaires, les défenseurs du pire opportunisme et de la social-trahison. Au fait, la brochure anonyme intitulée la Révolution mondiale (Weltrevolution), parue à Vienne en 1919 ("Sozialistische Biicherei", Heft II; Ignaz Brand), illustre avec une évidence particulière tout ce cheminement de la pensée, ou plus exactement tout cet abîme d'inconséquence, de pédantisme, de lâcheté et de trahison envers les intérêts de la classe ouvrière, le tout assorti de la "défense " de l'idée de "révolution mondiale". Mais nous nous arrêterons plus longuement sur cette brochure une autre fois. Bornons-nous à indiquer encore ceci: dans les temps très reculés où Kautsky était encore un marxiste, et non un renégat, en envisageant la question en historien, il prévoyait l'éventualité d'une situation dans laquelle l'esprit révolutionnaire du prolétariat russe devait servir de modèle pour l'Europe occidentale. C'était en 1902; Kautsky publia dans l'Iskra révolutionnaire un article intitulé "Les Slaves et la révolution". Voici ce qu'il y disait :
"A l'heure présente (contrairement à 1848), on peut penser que les Slaves ont non seulement pris rang parmi les peuples révolutionnaires, mais aussi que le centre de gravité de la pensée et de l'action révolutionnaire se déplace de plus en plus vers les Slaves. Le centre de la révolution se déplace d'Occident en Orient. Dans la première moitié du XIX° siècle, il se situait en France, par moments, en Angleterre. En 1848, l'Allemagne à son tour prit rang parmi les nations révolutionnaires... Le nouveau siècle débute par des événements qui nous font penser que nous allons au-devant d'un nouveau déplacement du centre de la révolution, à savoir : son déplacement vers la Russie... La Russie, qui a puisé tant d'initiative révolutionnaire en Occident, est peut-être maintenant sur le point d'offrir à ce dernier une source d'énergie révolutionnaire. Le mouvement révolutionnaire russe qui monte sera peut-être le moyen le plus puissant pour chasser l'esprit de philistinisme débile et de politicaillerie, esprit qui commence à se répandre dans nos rangs ; de nouveau ce mouvement fera jaillir en flammes ardentes la soif de lutte et l'attachement passionné à nos grands idéaux. La Russie a depuis longtemps cessé d'être pour l'Europe occidentale un simple rempart de la réaction et de l'absolutisme. Aujourd'hui, c'est peut-être exactement le contraire qui est vrai. L'Europe occidentale devient le rempart de la réaction et de l'absolutisme en Russie... Il y a longtemps que les révolutionnaires russes seraient peut-être venus à bout du tsar,' s'ils n'avaient pas eu à combattre à la fois son allié, le capital européen. Espérons que, cette fois, ils parviendront à terrasser les deux ennemis, et que la nouvelle "sainte alliance" s'effondrera plus vite que ses devanciers. Mais quelle que soit l'issue de la lutte actuellement engagée en Russie, le sang et les souffrances des martyrs qu'elle engendre malheureusement en nombre plus que suffisant, ne seront pas perdus. Ils féconderont les pousses de la révolution sociale dans le monde civilisé tout entier, les feront s'épanouir plus luxuriantes et plus rapides. En 1848, les Slaves furent ce gel rigoureux qui fit périr les fleurs du printemps populaire. Peut-être leur sera-t-il donné maintenant d'être la tempête qui rompra la glace de la réaction et apportera irrésistiblement un nouveau, un radieux printemps pour les peuples." (Karl Kautsky: "Les Slaves et la révolution", article paru dans l'lskra, journal révolutionnaire social-démocrate russe, n° 18, 10 mars 1902). Karl Kautsky écrivait très bien il y a dix-huit ans!
Posted by Hello

If you dont know this guy, YOU SUCK BIG TIME!!! This is the new album featuring Stevie Wonder and it's the bomb. Really, if you have'nt a smile on your face and need one, download this album or buy it.
Posted by Hello
Really something worthy to watch
Really awesome videos showing the dirty dialectic going on in Great Britain.
http://www.ninjatune.net/videos/video.php?type=ra&id=11
http://www.ninjatune.net/videos/video.php?type=ra&id=10
and so on and so forth...
http://www.ninjatune.net/videos/video.php?type=ra&id=11
http://www.ninjatune.net/videos/video.php?type=ra&id=10
and so on and so forth...
Iain Borden most precious book
Taken from: http://www.shef.ac.uk/socst/Shop/7review.pdf
Skateboarding, Space and the City: Architecture and the Body
Borden, Iain. Berg, Oxford, 2001 (reprinted April 2003), 318pp
ISBN 1 85973 488 X (Hardback)
ISBN 1 85973 493 6 (Paperback)
Skateboarders are not able to invent or manage highly technical moves such as the McTwist or 900 without having adequate skateboard terrains underneath their feet. It is this interaction between space (i.e. a constructed skatepark) and body (the skateboarder) that is the basis for Borden’s conception of architecture. He argues that space and body are internalised within each other. He states, "Architecture is both external and internal to skateboarding, its concrete presentness being at once the other and the accessible symmetry to the skateboarder’s physical activity – separate to, yet brought within, the skateboarding act" (135).
His argument moves on from describing the interactions of space and body in drained-out swimming pools and constructed skateparks to urban settings (chapter 7 and chapter 8). Many factors led to this step in the
skateboarding evolution. Skateparks were becoming too expensive to maintain especially with insurance costs. Moreover, skateparks were probably perceived as the antithesis to the anarchist tendencies of the skateboard subculture (chapter 6). Another aspect of change was that skateboard devices were becoming slimmer and lighter for higher ollies and other technical street moves.
The weakest aspect of this excellent book is the chapter on skateboarding as a subculture (chapter 6). Although it touches on key issues in regards to gender and homophobia, it could have touched on the idea that skateboarding is perhaps no different than any other male-dominated sport such as football or activity such as b-boying. Another point of criticism is that it makes generalisations on certain aspects of the subculture without convincing evidence. For instance, it is a bit farfetched to argue that skateboarders such as Christian Hosoi adopted gang culture to market his products by describing a photo of him wearing a black leather jacket (141).
Having been skateboarder myself along the California central coast in the late 80s, I feel Borden made a worthwhile attempt in capturing skateboarder sentiments on how they confront different spaces. It certainly rekindled memories of how a skateboard felt underneath my feet and the excitement from skating urban centres.
Reviewed by Manny Madriaga
Department of Sociological Studies, University of Sheffield.
Skateboarding, Space and the City: Architecture and the Body
Borden, Iain. Berg, Oxford, 2001 (reprinted April 2003), 318pp
ISBN 1 85973 488 X (Hardback)
ISBN 1 85973 493 6 (Paperback)
Drawing on the work of Henri Lefebvre, Borden asks readers to rethink architecture. It is not just about an object or thing. Architecture is an ongoing process constructed by space, time and social beings. As he states, "space is part of a dialectical process between itself and human agency; rather than an a priori entity space is produced by, and productive of, social being" (11). He applies this thinking in his historical examination of skateboarding.
Utilising a vast archive of skateboarding magazines as historical sources of evidence the author is able to observe what skaters thought were significant at a certain space and time. For him, this is a more reliable method of gathering data than conducting interviews or questionnaires especially when considering how spaces for skateboarding has constantly been transforming throughout the past 3 decades. Problems of reliability would be enhanced in an interview or questionnaire when a skateboarder is asked to recollect her/his description of a particular skatepark in the seventies and what s/he was able to do in it (5). Thus, Borden justifies his methodology rather convincingly.
He details how skateboarding has evolved from being a modified scooter in the fifties for children, to being a pastime reserved for US west coast surfers in the seventies, to being a "suburban pool party" where skateboarders carved emptied swimming pools, to becoming a distinctive urban youth subculture which exists today. For this history to have evolved, many factors have to be considered.
Borden, having been a skateboarder himself in the seventies and early eighties, identifies that the skateboard device (chapter 2) has always been in the process of modification. Its mutation reflects the spaces where skateboarders sought to skate. For instance, skateboarders in the seventies wanted to emulate surfing manoeuvres while riding downhill or carving ditches. Their mobility was restricted because the skateboards were small and narrow. It was not until the advent of carving swimming pools (chapter 3) that the demand for wider, longer boards with more durable trucks and wheels was heard. Not only did carving swimming pools or manufactured skateparks (chapter 4) determine the variability of the skateboard device, it also affected how skateboarders utilise space on the ground or in the air (chapter 5).
Skateboarders are not able to invent or manage highly technical moves such as the McTwist or 900 without having adequate skateboard terrains underneath their feet. It is this interaction between space (i.e. a constructed skatepark) and body (the skateboarder) that is the basis for Borden’s conception of architecture. He argues that space and body are internalised within each other. He states, "Architecture is both external and internal to skateboarding, its concrete presentness being at once the other and the accessible symmetry to the skateboarder’s physical activity – separate to, yet brought within, the skateboarding act" (135).
His argument moves on from describing the interactions of space and body in drained-out swimming pools and constructed skateparks to urban settings (chapter 7 and chapter 8). Many factors led to this step in the
skateboarding evolution. Skateparks were becoming too expensive to maintain especially with insurance costs. Moreover, skateparks were probably perceived as the antithesis to the anarchist tendencies of the skateboard subculture (chapter 6). Another aspect of change was that skateboard devices were becoming slimmer and lighter for higher ollies and other technical street moves.
In any event, Borden demonstrates a good awareness of how skateboarders perceive the and the elements contained within it such as handrails, stairs, benches, etc. For instance, he touches on the contrasting perception of handrails between non-skateboarders and skateboarders. While nonskateboarders may see handrails as tools for mobility up-and-down staircases, skateboarders see handrails as obstacles that are skateable.
The weakest aspect of this excellent book is the chapter on skateboarding as a subculture (chapter 6). Although it touches on key issues in regards to gender and homophobia, it could have touched on the idea that skateboarding is perhaps no different than any other male-dominated sport such as football or activity such as b-boying. Another point of criticism is that it makes generalisations on certain aspects of the subculture without convincing evidence. For instance, it is a bit farfetched to argue that skateboarders such as Christian Hosoi adopted gang culture to market his products by describing a photo of him wearing a black leather jacket (141).
Having been skateboarder myself along the California central coast in the late 80s, I feel Borden made a worthwhile attempt in capturing skateboarder sentiments on how they confront different spaces. It certainly rekindled memories of how a skateboard felt underneath my feet and the excitement from skating urban centres.
Reviewed by Manny Madriaga
Department of Sociological Studies, University of Sheffield.
CEPES HÉGÉMONIE
Taken from: http://www.er.uqam.ca/nobel/cepes/hegemonie.html
Hégémonie
Hegemony
Par Chantal RobichaudDépartement de science politiqueUniversité du Québec à MontréalFévrier 2001
Un État dominant exerce une fonction hégémonique s'il conduit le système d'États dans la direction qu'il choisit et si, ce faisant, il est perçu comme étant le défenseur de l'intérêt universel. (Arrighi 1993:150)[1]
Bien que le concept d'hégémonie (du russe gegemonyia) ait beaucoup évolué depuis son utilisation par les révolutionnaires que furent Lénine et Trotsky, l'idée centrale qu'il représente demeure la même, soit l'existence au sein du système international de diverses formes de pouvoir et d'influence exercées par des groupes sociaux dominants sur d'autres groupes subordonnés. En Relations internationales, on parle d'hégémonie mondiale, soit de la capacité que possède un État d'exercer des fonctions gouvernementales sur un système politique mondial composé d'États souverains (Arrighi 1993: 148).
Les théories gramsciennes ou néomarxistes démontrent que l'hégémonie fait référence à une forme de puissance qui ne relève pas que de dominance pure et simple; elle signifie également l'exercice d'un leadership intellectuel et moral (Gramsci 1971: 57) qui prétend représenter l'intérêt universel et qui s'étend au système interétatique. La priorité accordée aux fondements idéologiques et culturels explique le comment du consentement et de la participation des groupes subordonnés à des classes dominantes prétendant les représenter. En effet, les structures de l'hégémonie, parce qu'elles légitimisent l'ordre et les politiques nationales, créent des normes universelles et mettent en place des mécanismes et des institutions servant à établir des règles de droit et de comportement pour les États et les acteurs transnationaux, et facilitent l'enracinement des bases sociales et matérielles nécessaires à l'exercice du pouvoir par l'hégémon (Cox 1987: 172). Pour Cox, l'hégémonie dépasse donc le système d'États. Il faut la comprendre en tenant compte du fait que les idées et les conditions matérielles d'existence sont toujours en relation les unes avec les autres (ce qu'il nomme le matérialisme historique). En ce sens, l'ordre hégémonique découle de la propagation d'une culture commune par des classes sociales dominantes (Cox 1983: 56) et se maintient grâce aux moyens de production et aux relations complexes qui se nouent entre les classes sociales des différents pays (Cox 1983: 62).
Dans les années soixante-dix, le concept d'hégémonie a été central dans le développement des théories des Relations internationales, et principalement en économie politique internationale. L'école de l'économie-monde pousse ainsi plus loin la dimension économique de l'hégémonie: «l'hégémonie est une situation dans laquelle les biens d'un État du centre sont produits tellement efficacement qu'ils sont largement plus compétitifs que les biens d'autres États du centre, ce qui permet à cet État d'être le principal bénéficiaire de la maximisation du libre-marché mondial» (Wallerstein 1980: 38)[2].
De plus, la théorie de la stabilité hégémonique se retrouva au centre des analyses que développèrent les théories réalistes et qui s'opposèrent aux théories institutionnalistes. Les théoriciens de l'interdépendance font d'ailleurs la différence entre hégémonie et impérialisme: «contrairement à une puissance impérialiste, un hégémon ne peut créer et imposer des règles sans un certain degré de consentement de la part des autres États souverains» (Keohane 1984: 46)[3]. Aussi, la théorie des régimes affirme que l'hégémonie ne se définit pas seulement par les capacités matérielles et les ressources d'un territoire mais aussi par les valeurs et les formes de relations et de pouvoir déjà intégrées dans les structures du système international. Par exemple, pour John Ruggie, l'hégémonie américaine est passée au système interétatique en enracinant le principe de souveraineté des nations: «le système de loi moderne consiste en l'institutionnalisation de l'autorité publique à l'intérieur de domaines de juridiction mutuellement exclusifs» (Ruggie 1983: 275)[4]. Aussi, Ruggie dira que l'institutionnalisation de l'hégémonie américaine est possible, non pas parce que les structures du système le requièrent mais parce que le sens de l'exceptionalisme fondamental à l'identité des Américains a pu appuyer l'action des États-Unis au niveau mondial (Ruggie 1998: 14).
De leur côté, les théories réalistes, pour lesquelles un État hégémonique évoluant dans un système anarchique exerce son influence et impose sa force principalement par ses capacités matérielles et par sa prépondérance en termes de ressources militaires et économiques (Keohane 1984: 32), reconnaissent également que les aspects idéologiques et normatifs des formes de pouvoir permettant aux États dominants de rendre leur autorité moralement acceptable, donc plus facile à exercer (Morgenthau 1967: 87-88). Gilpin ajoutera que «les États les plus faibles d'un système international suivront le leadership des États les plus puissants, en partie parce qu'ils acceptent la légitimité et l'utilité de l'ordre existant» (Gilpin 1981:30)[5].
Bien qu'il existe des variantes de l'hégémonie en nombre suffisant pour satisfaire à peu près toutes les tendances (Strange 1987: 557), le concept d'hégémonie possède une valeur explicative importante puisqu'il permet d'illustrer les liens entre économie et politique et de réduire les écarts entre les politiques internes et les politiques internationales. La diffusion de normes et de valeurs associées au départ à certains groupes sociaux d'une nation particulière à des structures internes d'autres nations ou à des structures supranationales, est en effet le moment-clé de l'évolution et de la distribution de la puissance au niveau global.
Repères
Arrighi, Giovanni. 1993. «The Three Hegemonies of Historical Capitalism». Gill, Stephen (dir.). Gramsci, Historical Materialism and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
Cox, Robert. 1983. «Gramsci, Hegemony and International Relations: an Essay in Methods». Millenium: Journal of International Studies 12 (2): 162-175.
Cox, Robert. 1987. Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. New York: Colombia University Press.
Gilpin, Robert. 1981. War and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Gramsci, Antonio. 1971. Selections From the Prison Notebooks of Antonio Gramsci. Traduit par Quintin Hoare et Geoffrey Nowell Smith. New York : International Publishers. 483 p.
Keohane, Robert O. 1984 After hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. New Jersey: Princeton University Press. 291 p.
Morgenthau, Hans. 1967. Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace. 4iéme édition. New York: Alfred Knopf. 615 p.
Piotte, Jean-Marc. 1970. La pensée politique de Gramsci. Paris: Anthropos, coll. Sociologie et connaissance. 302 p.
Rioux, Jean-François, Eric Keenes et Greg Légaré. 1988. «Le néo-réalisme ou la reformulation du paradigme hégémonique». Études internationales 19 (1): 57-80.
Ruggie, John G. 1983. «Continuity and Transformation in the World Polity: Toward a Neorealist Synthesis». World Politics. 35 (2): 195-232.
Ruggie, John G. 1998. Constructing the World Polity: Essays on International Organization. Londres / New York: Routledge.
Strange, Susan. 1987. «The Persistent Myth of Lost Hegemony». International Organisation. 41 (4): 551-574.
[1] «A dominant state exercises a hegemonic function if it leads the system of states in a desired direction and, in so doing, is perceived as pursuing a universal interest» (Arrighi 1993: 150).
[2] «Hegemony is a situation wherein the products of a given core state are produced so efficiently that they are by and large competitive even in other core states, and therefore the given core state will be the primacy beneficiary of a maximally free world market» (Wallerstein 1980: 38).
[3] «...unlike an imperial power, an hegemon can not make and enforce rules without a certain degree of consent from other sovereign states» (Keohane 1984: 46).
[4] «...the modern system of rule consists of the institutionalisation of public authority within mutually exclusive jurisdictional domains» (Ruggie 1983: 275).
[5] «...the lesser states in an international system will follow the leadership of more powerful states, in part because they accept the legitimacy and utility of the existing order » (Gilpin 1981:30).
Hégémonie
Hegemony
Par Chantal RobichaudDépartement de science politiqueUniversité du Québec à MontréalFévrier 2001
Un État dominant exerce une fonction hégémonique s'il conduit le système d'États dans la direction qu'il choisit et si, ce faisant, il est perçu comme étant le défenseur de l'intérêt universel. (Arrighi 1993:150)[1]
Bien que le concept d'hégémonie (du russe gegemonyia) ait beaucoup évolué depuis son utilisation par les révolutionnaires que furent Lénine et Trotsky, l'idée centrale qu'il représente demeure la même, soit l'existence au sein du système international de diverses formes de pouvoir et d'influence exercées par des groupes sociaux dominants sur d'autres groupes subordonnés. En Relations internationales, on parle d'hégémonie mondiale, soit de la capacité que possède un État d'exercer des fonctions gouvernementales sur un système politique mondial composé d'États souverains (Arrighi 1993: 148).
Les théories gramsciennes ou néomarxistes démontrent que l'hégémonie fait référence à une forme de puissance qui ne relève pas que de dominance pure et simple; elle signifie également l'exercice d'un leadership intellectuel et moral (Gramsci 1971: 57) qui prétend représenter l'intérêt universel et qui s'étend au système interétatique. La priorité accordée aux fondements idéologiques et culturels explique le comment du consentement et de la participation des groupes subordonnés à des classes dominantes prétendant les représenter. En effet, les structures de l'hégémonie, parce qu'elles légitimisent l'ordre et les politiques nationales, créent des normes universelles et mettent en place des mécanismes et des institutions servant à établir des règles de droit et de comportement pour les États et les acteurs transnationaux, et facilitent l'enracinement des bases sociales et matérielles nécessaires à l'exercice du pouvoir par l'hégémon (Cox 1987: 172). Pour Cox, l'hégémonie dépasse donc le système d'États. Il faut la comprendre en tenant compte du fait que les idées et les conditions matérielles d'existence sont toujours en relation les unes avec les autres (ce qu'il nomme le matérialisme historique). En ce sens, l'ordre hégémonique découle de la propagation d'une culture commune par des classes sociales dominantes (Cox 1983: 56) et se maintient grâce aux moyens de production et aux relations complexes qui se nouent entre les classes sociales des différents pays (Cox 1983: 62).
Dans les années soixante-dix, le concept d'hégémonie a été central dans le développement des théories des Relations internationales, et principalement en économie politique internationale. L'école de l'économie-monde pousse ainsi plus loin la dimension économique de l'hégémonie: «l'hégémonie est une situation dans laquelle les biens d'un État du centre sont produits tellement efficacement qu'ils sont largement plus compétitifs que les biens d'autres États du centre, ce qui permet à cet État d'être le principal bénéficiaire de la maximisation du libre-marché mondial» (Wallerstein 1980: 38)[2].
De plus, la théorie de la stabilité hégémonique se retrouva au centre des analyses que développèrent les théories réalistes et qui s'opposèrent aux théories institutionnalistes. Les théoriciens de l'interdépendance font d'ailleurs la différence entre hégémonie et impérialisme: «contrairement à une puissance impérialiste, un hégémon ne peut créer et imposer des règles sans un certain degré de consentement de la part des autres États souverains» (Keohane 1984: 46)[3]. Aussi, la théorie des régimes affirme que l'hégémonie ne se définit pas seulement par les capacités matérielles et les ressources d'un territoire mais aussi par les valeurs et les formes de relations et de pouvoir déjà intégrées dans les structures du système international. Par exemple, pour John Ruggie, l'hégémonie américaine est passée au système interétatique en enracinant le principe de souveraineté des nations: «le système de loi moderne consiste en l'institutionnalisation de l'autorité publique à l'intérieur de domaines de juridiction mutuellement exclusifs» (Ruggie 1983: 275)[4]. Aussi, Ruggie dira que l'institutionnalisation de l'hégémonie américaine est possible, non pas parce que les structures du système le requièrent mais parce que le sens de l'exceptionalisme fondamental à l'identité des Américains a pu appuyer l'action des États-Unis au niveau mondial (Ruggie 1998: 14).
De leur côté, les théories réalistes, pour lesquelles un État hégémonique évoluant dans un système anarchique exerce son influence et impose sa force principalement par ses capacités matérielles et par sa prépondérance en termes de ressources militaires et économiques (Keohane 1984: 32), reconnaissent également que les aspects idéologiques et normatifs des formes de pouvoir permettant aux États dominants de rendre leur autorité moralement acceptable, donc plus facile à exercer (Morgenthau 1967: 87-88). Gilpin ajoutera que «les États les plus faibles d'un système international suivront le leadership des États les plus puissants, en partie parce qu'ils acceptent la légitimité et l'utilité de l'ordre existant» (Gilpin 1981:30)[5].
Bien qu'il existe des variantes de l'hégémonie en nombre suffisant pour satisfaire à peu près toutes les tendances (Strange 1987: 557), le concept d'hégémonie possède une valeur explicative importante puisqu'il permet d'illustrer les liens entre économie et politique et de réduire les écarts entre les politiques internes et les politiques internationales. La diffusion de normes et de valeurs associées au départ à certains groupes sociaux d'une nation particulière à des structures internes d'autres nations ou à des structures supranationales, est en effet le moment-clé de l'évolution et de la distribution de la puissance au niveau global.
Repères
Arrighi, Giovanni. 1993. «The Three Hegemonies of Historical Capitalism». Gill, Stephen (dir.). Gramsci, Historical Materialism and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
Cox, Robert. 1983. «Gramsci, Hegemony and International Relations: an Essay in Methods». Millenium: Journal of International Studies 12 (2): 162-175.
Cox, Robert. 1987. Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. New York: Colombia University Press.
Gilpin, Robert. 1981. War and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Gramsci, Antonio. 1971. Selections From the Prison Notebooks of Antonio Gramsci. Traduit par Quintin Hoare et Geoffrey Nowell Smith. New York : International Publishers. 483 p.
Keohane, Robert O. 1984 After hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. New Jersey: Princeton University Press. 291 p.
Morgenthau, Hans. 1967. Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace. 4iéme édition. New York: Alfred Knopf. 615 p.
Piotte, Jean-Marc. 1970. La pensée politique de Gramsci. Paris: Anthropos, coll. Sociologie et connaissance. 302 p.
Rioux, Jean-François, Eric Keenes et Greg Légaré. 1988. «Le néo-réalisme ou la reformulation du paradigme hégémonique». Études internationales 19 (1): 57-80.
Ruggie, John G. 1983. «Continuity and Transformation in the World Polity: Toward a Neorealist Synthesis». World Politics. 35 (2): 195-232.
Ruggie, John G. 1998. Constructing the World Polity: Essays on International Organization. Londres / New York: Routledge.
Strange, Susan. 1987. «The Persistent Myth of Lost Hegemony». International Organisation. 41 (4): 551-574.
[1] «A dominant state exercises a hegemonic function if it leads the system of states in a desired direction and, in so doing, is perceived as pursuing a universal interest» (Arrighi 1993: 150).
[2] «Hegemony is a situation wherein the products of a given core state are produced so efficiently that they are by and large competitive even in other core states, and therefore the given core state will be the primacy beneficiary of a maximally free world market» (Wallerstein 1980: 38).
[3] «...unlike an imperial power, an hegemon can not make and enforce rules without a certain degree of consent from other sovereign states» (Keohane 1984: 46).
[4] «...the modern system of rule consists of the institutionalisation of public authority within mutually exclusive jurisdictional domains» (Ruggie 1983: 275).
[5] «...the lesser states in an international system will follow the leadership of more powerful states, in part because they accept the legitimacy and utility of the existing order » (Gilpin 1981:30).
Francis Fukuyama's critic of Negri & Hardt
taken from: http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=1545
’Multitude’ : An Antidote to Empire
MULTITUDE : War and Democracy in the Age of Empire.
par Francis Fukuyama
Well before 9/11 and the Iraq war put the idea in everybody’s mind, Michael Hardt and Antonio Negri had popularized the notion of a modern empire. Four years ago, they argued in a widely discussed book -- titled, as it happens, ’’Empire’’ -- that the globe was ruled by a new imperial order, different from earlier ones, which were based on overt military domination. This one had no center ; it was managed by the world’s wealthy nation-states (particularly the United States), by multinational corporations and by international institutions like the World Trade Organization and the International Monetary Fund. This empire -- a k a globalization -- was exploitative, undemocratic and repressive, not only for developing countries but also for the excluded in the rich West.
Hardt and Negri’s new book, ’’Multitude,’’ argues that the antidote to empire is the realization of true democracy, ’’the rule of everyone by everyone, a democracy without qualifiers.’’ They say that the left needs to leave behind outdated concepts like the proletariat and the working class, which vastly oversimplify the gender/racial/ethnic/ class diversities of today’s world. In their place they propose the term ’’multitude,’’ to capture the ’’commonality and singularity’’ of those who stand in opposition to the wealthy and powerful.
This book -- which lurches from analyses of intellectual property rules for genetically engineered animals to discourses on Dostoyevsky and the myth of the golem -- deals with an imaginary problem and a real problem. Unfortunately, it provides us with an imaginary solution to the real problem.
The imaginary problem stems from the authors’ basic understanding of economics and politics, which remains at its core unreconstructedly Marxist. For them, there is no such thing as voluntary economic exchange, only coercive political hierarchy : any unequal division of rewards is prima facie evidence of exploitation. Private property is a form of theft. Globalization has no redeeming benefits whatsoever. (East Asia’s rise from third- to first-world status in the last 50 years seems not to have registered on their mental map.) Similarly, democracy is not embodied in constitutions, political parties or elections, which are simply manipulated to benefit elites. The half of the country that votes Republican is evidently not part of the book’s multitude.
To all this Hardt and Negri add an extremely confused theory, their take on what Daniel Bell labeled postindustrial society, and what has more recently been called the ’’knowledge economy.’’ The ’’immaterial labor’’ of knowledge workers differs from labor in the industrial era, Hardt and Negri say, because it produces not objects but social relations. It is inherently communal, which implies that no one can legitimately appropriate it for private gain. Programmers at Microsoft may be surprised to discover that because they collaborate with one another, their programs belong to everybody.
It’s hard to know even how to engage this set of assertions. Globalization is a complex phenomenon ; it produces winners and losers among rich and poor alike. But you would never learn about the complexities from reading ’’Multitude.’’ So let’s move on to Hardt and Negri’s real problem, which has to do with global governance.
We have at this point in human history evolved fairly good democratic political institutions, but only at the level of the nation-state. With globalization -- and increased flows of information, goods, money and people across borders -- countries are now better able to help, but also to harm, one another. In the 1990’s, the harm was felt primarily through financial shocks and job losses, and since 9/11 it has acquired a military dimension as well. As the authors state, ’’one result of the current form of globalization is that certain national leaders, both elected and unelected, gain greater powers over populations outside their own nation-states.’’
The United States is uniquely implicated in this charge because of its enormous military, economic and cultural power. What drove people around the world crazy about the Bush administration’s unilateral approach to the Iraq war was its assertion that it was accountable to no one but American voters for what it did in distant parts of the globe. And since institutions like the United Nations are woefully ill equipped to deal with democratic legitimacy, this democracy deficit is a real and abiding challenge at the international level.
The authors are conscious of the charge that they, like the Seattle anti-globalization protesters they celebrate, don’t have any real solutions to these matters, so they spend some time discussing how to fix the present international institutions. Their problem is that any fixes are politically difficult if not impossible to bring about, and promise only marginal benefits. Democratic institutions that work at the nation-state level don’t work at global levels. A true global democracy, in which all of the earth’s billions of people actually vote, is an impossible dream, while existing proposals to modify the United Nations Security Council or change the balance of power between it and the General Assembly are political nonstarters. Making the World Bank and I.M.F. more transparent are worthy projects, but hardly solutions to the underlying issue of democratic accountability. The United States, meanwhile, has stood in the way of new institutions like the International Criminal Court.
It is at this point that Hardt and Negri take leave of reality -- arriving at an imaginary solution to their real problem. They argue that instead of ’’repeating old rituals and tired solutions’’ we need to begin ’’a new investigation in order to formulate a new science of society and politics.’’ The woolliness of the subsequent analysis is hard to overstate. According to them, the fundamental obstacle to true democracy is not just the monopoly of legitimate force held by nation-states, but the dominance implied in virtually all hierarchies, which give certain individuals authority over others. The authors dress up Marx’s old utopia of the withering away of the state in the contemporary language of chaos theory and biological systems, suggesting that hierarchies should be replaced with networks that reflect the diversity and commonality of the ’’multitude.’’
The difficulty with this line of reasoning is that there is a whole class of issues networks can’t resolve. This is why hierarchies, from nation-states to corporations to university departments, persist, and why so many left-wing movements claiming to speak on behalf of the people have ended up monopolizing power. Indeed, the powerlessness and poverty in today’s world are due not to the excessive power of nation-states, but to their weakness. The solution is not to undermine sovereignty but to build stronger states in the developing world.
To illustrate, take the very different growth trajectories of East Asia and sub-Saharan Africa over the past generation. Two of the fastest growing economies in the world today happen to be in the two most populous countries, China and India ; sub-Saharan Africa, by contrast, has tragically seen declining per capita incomes over the same period. At least part of this difference is the result of globalization : China and India have integrated themselves into the global economy, while sub-Saharan Africa is the one part of the world barely touched by globalization or multinational corporations.
But this raises the question of why India and China have been able to take advantage of globalization, while Africa has not. The answer has largely to do with the fact that the former have strong, well-developed state institutions providing basic stability and public goods. They had only to get out of the way of private markets to trigger growth. By contrast, modern states were virtually unknown in most of sub-Saharan Africa before European colonialism, and the weakness of states in the region has been the source of its woes ever since.
Any project, then, to fix the ills of ’’empire’’ has to begin with the strengthening, not the dismantling, of institutions at the nation-state level. This will not solve the problems of global governance, but surely any real advance here will come only through slow, patient innovation and the reform of international institutions. Hardt and Negri should remember the old insight of the Italian Marxist Antonio Gramsci, taken up later by the German Greens : progress is to be achieved not with utopian dreaming, but with a ’’long march through institutions.’’
Francis Fukuyama, a professor of international political economy at Johns Hopkins University, is the author of ’’State-Building : Governance and World Order in the 21st Century.’’
’Multitude’ : An Antidote to Empire
MULTITUDE : War and Democracy in the Age of Empire.
par Francis Fukuyama
Well before 9/11 and the Iraq war put the idea in everybody’s mind, Michael Hardt and Antonio Negri had popularized the notion of a modern empire. Four years ago, they argued in a widely discussed book -- titled, as it happens, ’’Empire’’ -- that the globe was ruled by a new imperial order, different from earlier ones, which were based on overt military domination. This one had no center ; it was managed by the world’s wealthy nation-states (particularly the United States), by multinational corporations and by international institutions like the World Trade Organization and the International Monetary Fund. This empire -- a k a globalization -- was exploitative, undemocratic and repressive, not only for developing countries but also for the excluded in the rich West.
Hardt and Negri’s new book, ’’Multitude,’’ argues that the antidote to empire is the realization of true democracy, ’’the rule of everyone by everyone, a democracy without qualifiers.’’ They say that the left needs to leave behind outdated concepts like the proletariat and the working class, which vastly oversimplify the gender/racial/ethnic/ class diversities of today’s world. In their place they propose the term ’’multitude,’’ to capture the ’’commonality and singularity’’ of those who stand in opposition to the wealthy and powerful.
This book -- which lurches from analyses of intellectual property rules for genetically engineered animals to discourses on Dostoyevsky and the myth of the golem -- deals with an imaginary problem and a real problem. Unfortunately, it provides us with an imaginary solution to the real problem.
The imaginary problem stems from the authors’ basic understanding of economics and politics, which remains at its core unreconstructedly Marxist. For them, there is no such thing as voluntary economic exchange, only coercive political hierarchy : any unequal division of rewards is prima facie evidence of exploitation. Private property is a form of theft. Globalization has no redeeming benefits whatsoever. (East Asia’s rise from third- to first-world status in the last 50 years seems not to have registered on their mental map.) Similarly, democracy is not embodied in constitutions, political parties or elections, which are simply manipulated to benefit elites. The half of the country that votes Republican is evidently not part of the book’s multitude.
To all this Hardt and Negri add an extremely confused theory, their take on what Daniel Bell labeled postindustrial society, and what has more recently been called the ’’knowledge economy.’’ The ’’immaterial labor’’ of knowledge workers differs from labor in the industrial era, Hardt and Negri say, because it produces not objects but social relations. It is inherently communal, which implies that no one can legitimately appropriate it for private gain. Programmers at Microsoft may be surprised to discover that because they collaborate with one another, their programs belong to everybody.
It’s hard to know even how to engage this set of assertions. Globalization is a complex phenomenon ; it produces winners and losers among rich and poor alike. But you would never learn about the complexities from reading ’’Multitude.’’ So let’s move on to Hardt and Negri’s real problem, which has to do with global governance.
We have at this point in human history evolved fairly good democratic political institutions, but only at the level of the nation-state. With globalization -- and increased flows of information, goods, money and people across borders -- countries are now better able to help, but also to harm, one another. In the 1990’s, the harm was felt primarily through financial shocks and job losses, and since 9/11 it has acquired a military dimension as well. As the authors state, ’’one result of the current form of globalization is that certain national leaders, both elected and unelected, gain greater powers over populations outside their own nation-states.’’
The United States is uniquely implicated in this charge because of its enormous military, economic and cultural power. What drove people around the world crazy about the Bush administration’s unilateral approach to the Iraq war was its assertion that it was accountable to no one but American voters for what it did in distant parts of the globe. And since institutions like the United Nations are woefully ill equipped to deal with democratic legitimacy, this democracy deficit is a real and abiding challenge at the international level.
The authors are conscious of the charge that they, like the Seattle anti-globalization protesters they celebrate, don’t have any real solutions to these matters, so they spend some time discussing how to fix the present international institutions. Their problem is that any fixes are politically difficult if not impossible to bring about, and promise only marginal benefits. Democratic institutions that work at the nation-state level don’t work at global levels. A true global democracy, in which all of the earth’s billions of people actually vote, is an impossible dream, while existing proposals to modify the United Nations Security Council or change the balance of power between it and the General Assembly are political nonstarters. Making the World Bank and I.M.F. more transparent are worthy projects, but hardly solutions to the underlying issue of democratic accountability. The United States, meanwhile, has stood in the way of new institutions like the International Criminal Court.
It is at this point that Hardt and Negri take leave of reality -- arriving at an imaginary solution to their real problem. They argue that instead of ’’repeating old rituals and tired solutions’’ we need to begin ’’a new investigation in order to formulate a new science of society and politics.’’ The woolliness of the subsequent analysis is hard to overstate. According to them, the fundamental obstacle to true democracy is not just the monopoly of legitimate force held by nation-states, but the dominance implied in virtually all hierarchies, which give certain individuals authority over others. The authors dress up Marx’s old utopia of the withering away of the state in the contemporary language of chaos theory and biological systems, suggesting that hierarchies should be replaced with networks that reflect the diversity and commonality of the ’’multitude.’’
The difficulty with this line of reasoning is that there is a whole class of issues networks can’t resolve. This is why hierarchies, from nation-states to corporations to university departments, persist, and why so many left-wing movements claiming to speak on behalf of the people have ended up monopolizing power. Indeed, the powerlessness and poverty in today’s world are due not to the excessive power of nation-states, but to their weakness. The solution is not to undermine sovereignty but to build stronger states in the developing world.
To illustrate, take the very different growth trajectories of East Asia and sub-Saharan Africa over the past generation. Two of the fastest growing economies in the world today happen to be in the two most populous countries, China and India ; sub-Saharan Africa, by contrast, has tragically seen declining per capita incomes over the same period. At least part of this difference is the result of globalization : China and India have integrated themselves into the global economy, while sub-Saharan Africa is the one part of the world barely touched by globalization or multinational corporations.
But this raises the question of why India and China have been able to take advantage of globalization, while Africa has not. The answer has largely to do with the fact that the former have strong, well-developed state institutions providing basic stability and public goods. They had only to get out of the way of private markets to trigger growth. By contrast, modern states were virtually unknown in most of sub-Saharan Africa before European colonialism, and the weakness of states in the region has been the source of its woes ever since.
Any project, then, to fix the ills of ’’empire’’ has to begin with the strengthening, not the dismantling, of institutions at the nation-state level. This will not solve the problems of global governance, but surely any real advance here will come only through slow, patient innovation and the reform of international institutions. Hardt and Negri should remember the old insight of the Italian Marxist Antonio Gramsci, taken up later by the German Greens : progress is to be achieved not with utopian dreaming, but with a ’’long march through institutions.’’
Francis Fukuyama, a professor of international political economy at Johns Hopkins University, is the author of ’’State-Building : Governance and World Order in the 21st Century.’’
S'abonner à :
Messages (Atom)